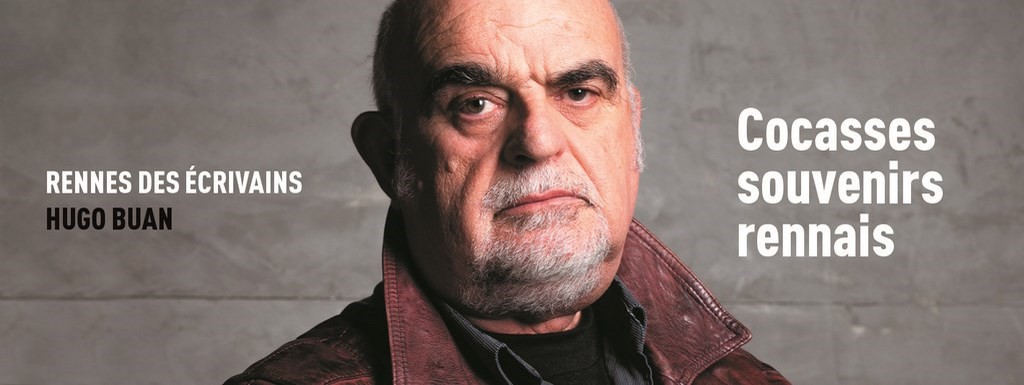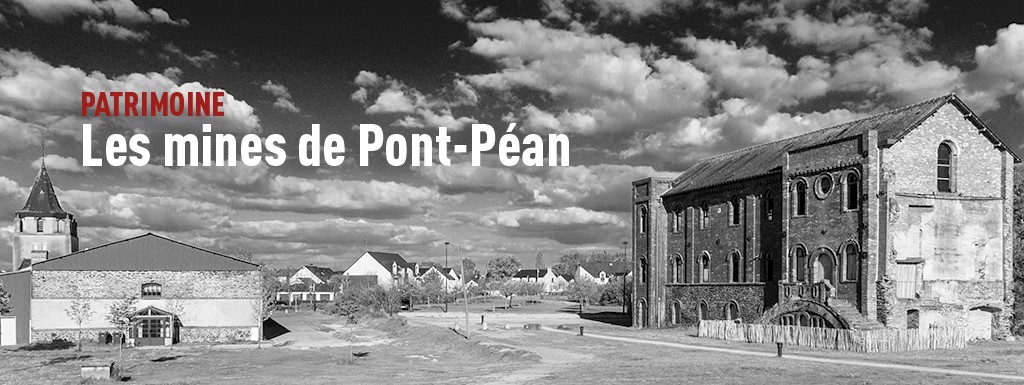Illustre et fabuleux Picasso ! L'aurons-nous assez dit en rappelant que le marché de l’art l’a poussé, le 11 mai 2015, à New York, chez Christie’s, jusqu’au prix exceptionnel de 176,36 millions de dollars ? Oui, l’équivalent de 160 millions d’euros pour Les Femmes d’Alger (version originale), œuvre réalisée en 1955, en mémoire d’Eugène Delacroix, qu’il admirait. Parce que c’est une donnée à ne point négliger : le virtuose catalan, tenu pour un génie spontané, avait, dans son enfance, beaucoup étudié les maîtres d’antan. Il avait copié le Greco, regardé chez Goya et pris, abondamment, chez Cézanne. Puis, une curiosité chassant l’autre, ce petit homme aux yeux de braise s’était approprié les formes des masques africains que lui avait révélées Maurice Vlaminck, l’un des fondateurs du fauvisme. On connaît la suite : le prodige des Demoiselles d’Avignon, toile grandissime terminée en 1907 à Paris, sur le site légendaire du Bateau-Lavoir. Un coup de tonnerre, vraiment, qu’André Breton signala comme « l’événement capital du 20e siècle ». Plus sûrement, c’était la preuve que le jeune Espagnol, né le 25 octobre 1881 à Malaga d’un père professeur de peinture, quittait sa première manière, très classique, pour forcer toutes les permissions qu’accordait le modernisme. La preuve, en somme, qu’il s’avérait particulièrement décidé, et qu’il ne reculerait devant rien afin de gagner son droit d’exister. Car tel était alors l’enjeu : non pas les trompettes de la gloire, mais le pain quotidien, dont il était souvent dépourvu lorsqu’il peignait rue Ravignan. Daniel-Henry Kahnweiler, son futur marchand, qui assurerait leur fortune réciproque, l’a raconté dans un livre d’entretiens : « [sa] solitude morale à cette époque était quelque chose d’effrayant, car aucun de ses amis peintres ne l’avait suivi. Le tableau qu’il avait peint là paraissait à tous quelque chose de fou ou de monstrueux . »
Était-il lancé ? Non. Mais il s’appuyait dorénavant sur une galerie et pouvait doubler le pas, produisant avec une énergie rare. Pour le reste, comment ne pas souligner le rôle joué concurremment par les poètes, Apollinaire et André Salmon se trouvant bientôt à court de mots pour vanter, tantôt les collages, tantôt les sculptures et les schèmes nouveaux qu’engendrait le titan ? Ce qui lui vaudrait, au début des années quarante, la remarque judicieuse d’André Lhote, sans doute le meilleur critique d’art que la période ait connu (mais il était également un artiste fameux) : « L’immense talent de Picasso, talent de peintre et de dessinateur, est indiscutable, même pour qui se cabre devant l’imprudence des commentateurs attitrés. Le florilège picassien est certainement le plus riche en incongruités laudatives, en extases plus ou moins convulsives. » Cependant, tiré par son étoile, tiré aussi par l’empressement d’un monde ballotté entre deux guerres, l’intéressé persévérait, posant déjà pour la postérité.
Oui, c’était son deuxième séjour dans la station balnéaire. Il l’avait découverte en juillet 1922, pressé par Olga, sa première épouse, laquelle cherchait un air sain – elle s’inquiétait de la santé de leur fils Paulo. Suivant son habitude, Pablo Picasso en avait profité pour beaucoup dessiner, principalement des maternités d’une facture traditionnelle, des natures mortes cubistes et des vues de Saint-Malo croquées depuis les jardins de la villa Beauregard que le couple avait louée. Moments de bonheur : les pas malhabiles de l’enfant l’éblouissaient ; et il s’épatait, en bon Méditerranéen, de l’importance des marées sur la Côte d’Émeraude… Il y était donc revenu en 1928 (il avait 46 ans), toujours avec Olga, toujours avec Paulo, et toujours le crayon ou la palette à la main. Mais, comment dire ? il donnait le change, épiant sans cesse les fenêtres de la pension où l’attendait Marie-Thé- rèse Walter, sa jeune maîtresse, rencontrée boulevard Haussmann, à Paris. « Mademoiselle, vous avez un visage intéressant. Je voudrais faire votre portrait… Je sens que nous ferons de grandes choses ensemble… Je suis Picasso », avait-il déclaré5 . Été d’espérances, de mensonges, de drames conjugaux… Gardait-il toute sa tête ? Ses détracteurs en doutèrent. Seule certitude : il peignait comme jamais. Non plus des hommes et des femmes, mais des fragments, des débris, des rognures d’humanité ! Tel était son dernier style, qu’il voulait définitivement imposer : ni tronc, ni jambes, ni bras, et à peine un trait pour la bouche ! Ainsi œuvrerait-il à l’avenir, jetant sur les toiles d’insolites étirements ou d’extravagantes compressions que se disputeraient des collectionneurs fortunés. Dans l’histoire de l’art, cette aventure porte un nom : « La période de Dinard ». Elle connut un bis repetita placent en août 1929, lors de l’ultime séjour de Pablo Picasso dans la ville. Encore en compagnie d’Olga, et encore guettant Marie-Thérèse… Et puis peignant, comme personne !