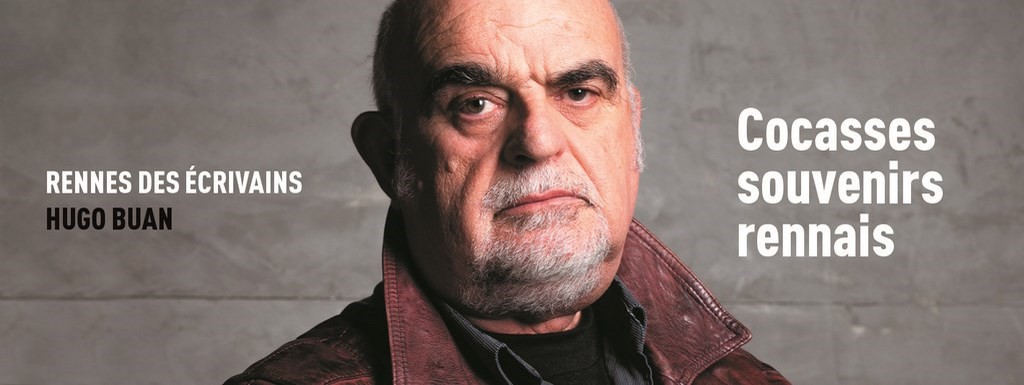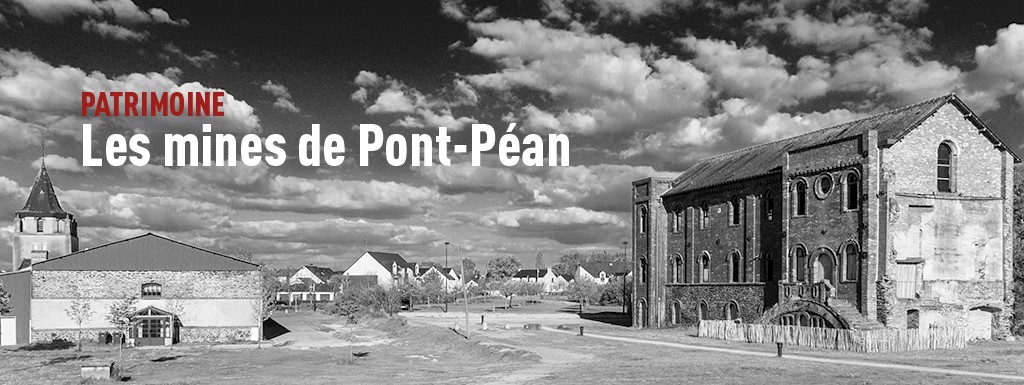Il fut « la bête noire de la grande majorité des Rennais1 », au gré des phobies desquels il était « un français d’hier », « un Hongrois », « un Allemand », « un Tzigane », un « professeur israélite », « l’Austro- Hongrois ». Ou « le juif Basch ». Et pourtant, en 1938, évoquant ce qu’avait été sa vie à Rennes au temps de l’affaire Dreyfus, Victor Basch, l’homme qui inspira ce triste concours de xénophobie et d’antisémitisme, écrivait dans les Cahiers des Droits de l’Homme : « Je viens de fouiller dans ma mémoire, et voici que j’ai vu ressurgir des ombres du passé la plus belle période de ma vie — la plus belle parce que la plus militante et la plus dangereuse3. »
Rien ne le prédisposait à avoir le moindre lien avec Rennes. Né à Budapest en 1863, et, on l’a compris, d’origine juive, il avait émigré en France avec ses parents à l’âge de 2 ans et demi (c’est donc tout naturellement qu’il trouve sa place dans le récent Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France dirigé par Pascal Ory4). Mais ayant, après de brillantes études, passé une licence de philosophie et l’agrégation d’allemand, il est nommé en 1889 chargé de cours (de littérature étrangère, ce qui ne pouvait qu’aggraver son cas5 !) à la Faculté des lettres de Rennes, alors située dans l’actuel musée des beauxarts. Il y est toujours, quelques années plus tard, lorsque l’affaire Dreyfus vient bouleverser totalement sa vie, et faire de lui, définitivement, un homme engagé.
Victor Basch a lui-même évoqué à plusieurs reprises6 l’origine de son engagement, racontant comment en octobre 1897, il entendit, pour la première fois, affirmer que « le capitaine Dreyfus, avait été condamné injustement et illégalement », puis comment, ayant résolu avec quelques collègues7 « de suivre de près l’Affaire et d’étudier tous les documents avec le sévère scrupule [qu’ils apportaient] à [leurs] recherches scientifiques », ils acquirent « la conviction que Dreyfus était innocent. »
Le dreyfusisme de Victor Basch est d’abord une attitude intellectuelle, qui consiste à opposer à la raison d’État, comme à tous les dogmes qui interdisent la discussion au nom d’une autorité supérieure, la rigueur d’un raisonnement appuyé sur le sens critique. Ce que l’on appelle à l’époque, d’une belle expression, « l’esprit d’examen ». Devenir dreyfusard en 1897-98, c’est en effet penser à contre-courant de tout ce que proclament le pouvoir politique et les chefs de l’Armée. À savoir que l’honneur de l’Armée, donc la sécurité de la France, interdirait de supposer que le jugement du Conseil de guerre de 1894, par lequel le capitaine Dreyfus a été condamné au bagne à perpétuité pour trahison au bénéfice de l’Allemagne pourrait être à la fois illégal et totalement inique. À contre-courant aussi de ce que répète à satiété la presse rennaise, nationaliste et antisémite, et qui va de « Dreyfus est forcément coupable, puisque juif » à « même s’il n’est pas vraiment coupable, ce n’est qu’un juif, après tout » ! Ceux qui veulent penser autrement, les dreyfusards, ne seraient que de mauvais Français, vendus au « cosmopolitisme judéo-maçonnique ».
Une fois acquise la conviction que Dreyfus était innocent, « nous nous sommes, écrit Basch, lancés à corps perdu dans la bataille. » Il s’agit de convertir ce qui n’était encore qu’intime en un geste public. Franchir le pas qui mène de la pensée à l’action, avec les risques que cela suppose.
En janvier 1898, après le scandaleux acquittement du vrai coupable, le commandant Ferdinand Esterhazy, Zola a donné le signal du refus par son fameux J’Accuse. Dans les jours qui suivent, ils sont des centaines, universitaires, savants, écrivains, artistes, à lui emboîter le pas en signant, dans L’Aurore ou dans Le Siècle, ce qu’on appela alors les « protestations » dont les signataires demandaient la révision du procès de Dreyfus, et que l’on appelle plus souvent aujourd’hui la pétition des intellectuels. « Immense émotion à Rennes, ville cléricale, chouanne, où, en dehors de quelques intellectuels, personne ne doutait de la culpabilité du capitaine juif et où tout doute émis sur celle-ci apparaissait comme un crime envers la patrie et l’armée qui en avait la garde. » C’est en effet affronter les préjugés de l’écrasante majorité des habitants de Rennes, où l’antisémitisme (dans une ville où il y en tout et pour tout onze familles juives…) s’exprime quotidiennement dans la presse locale avec parfois une extrême violence : « Il faut, selon tel journal, restituer la France aux Français, mettre les Français à l’aise chez eux », ou, selon tel autre, « rendre à la patrie sa vitalité en éliminant sans pitié ses éléments de mort ». C’est-à-dire éliminer « le cosmopolitisme et les habitants des ghettos » ou « éconduire cette plaie grouillante de sauterelles juives qui nous sucent jusqu’aux moelles ».
Vont s’ensuivre, du 16 au 20 janvier 1898, cinq jours de manifestations, de plus en plus violentes, dont Basch est la principale cible. Son nom est conspué dans les rues de Rennes, des étudiants demandent au Recteur son déplacement ou sa démission. La presse locale va de l’allusion fielleuse : « comment des étrangers arrivent-ils si facilement à forcer les portes de l’Université quand tant de bons Français n’y arrivent pas8 ? », à la pire violence verbale, « Le citoyen Basch veut-il contraindre les Rennais à aller l’enfumer dans sa tanière9 ? »
« C’est sur moi, qui, en ma qualité de juif, étais le plus vulnérable, que s’amoncela la colère populaire : assauts donnés à ma maison et tentatives de l’incendier — carreaux cassés — insultes à mes enfants que je suis obligé de retirer du lycée, menaces de mort qui — un jour que je n’oublierai pas et où je ne fus sauvé de la noyade que par l’intervention de deux de mes collègues — manquèrent de peu de devenir réalité. » Mais l’intimidation n’a pas d’effet sur Victor Basch. « Coups de langue ou coups de pierres » écrit-il, « que valent pour des hommes de conscience des considérations de cet ordre à côté du désir de proclamer la vérité ? », et il conclut tranquillement : « Je me prépare à la lutte. »
Mais cela ne suffit pas encore. « Nous étions sept contre soixante-dix mille », dira-t-il plus tard. C’est héroïque, certes, mais on ne défend pas une cause tout seul, ni à sept. Il faut donc examiner la situation, en quelque sorte la problématiser : « Ce n’était pas les sept intellectuels que nous étions qui pouvaient affronter les haines contre nous conjurées de toute une ville… » « Sur qui appuyer notre action ? ». « Comment recruter ? ». Pour espérer agir sur les événements, il faut élargir le minuscule noyau dreyfusard initial. Et cela est compliqué. C’est aussi une affaire d’intelligence et d’énergie politiques.
Et pourtant… le 22 janvier 1899, est fondée, chez Basch (tout un symbole !) la section de Rennes de la Ligue des droits de l’Homme, une des premières en France. Et parmi les 21 membres fondateurs, il y a, à côté de Basch, de ses six collègues et de deux de leurs étudiants, des protestants, des francs-maçons, quelques fonctionnaires républicains très modérés, refusant tous les excès de l’antidreyfusisme, et des ouvriers. Et cette section va s’étoffer au fil des mois, si bien que lorsque le 3 juin, quand Dreyfus est renvoyé devant le Conseil de guerre de Rennes, Basch peut dire : « Nous sommes prêts »... tout en écrivant à Joseph Reinach qu’« il était fou de faire siéger le Conseil de guerre dans une des villes où les passions sont le plus violemment déchaînées et où les officiers subissent fatalement la pression d’une société ardemment cléricale et résolument antisémite10. »
Il serait trop long de raconter en détail comment s’est constituée cette sorte de petit Front populaire avant la lettre et à l’échelle rennaise. Il fallut, selon les mots de Basch, faire « de la propagande » afin que « la lumière pénètre les esprits », nous dirions aujourd’hui de la pédagogie, et cela prit la forme d’une dizaine de conférences (sur invitation) à la Bourse du Travail. Drôle d’aventure pour ces professeurs d’université – dont la plupart, selon le mot de Basch « n’avaient jamais vu de près un ouvrier ». C’est encore lui qui ouvrit le feu11, et l’on nous dit que son « verbe éclatant » fut pour beaucoup dans le succès de l’entreprise, où chaque conférence fut l’occasion d’engranger de nouvelles adhésions.
Même encore très minoritaires, les ligueurs rennais peuvent désormais s’appuyer sur « la force des ouvriers » pour être à leur tour « maîtres de la rue » : « Les étudiants nationalistes qui venaient presque tous les soirs faire des manifestations devant mes fenêtres trouvèrent à qui parler. » Comprenons qu’ils se firent copieusement « rosser », et se le tinrent pour dit… Chose totalement impensable si l’on repense aux émeutes de janvier 1898, la section peut organiser le 14 juillet 1899, à l’auberge des Trois Marches (aujourd’hui Lecoq-Gadby), un banquet dit républicain démocratique, en réalité carrément dreyfusard, dont le succès dépasse les espérances de ses promoteurs : « J’avais compté sur 150 personnes, et voilà que nous sommes 260 ».
Trois semaines après ce mémorable 14 juillet, commençait le procès Dreyfus. Les lettres de Basch à son épouse Ilona12 nous font connaître, pour ainsi dire de l’intérieur, et à chaud, la façon dont il vit ces moments intenses, où il va de « journées folles » en « journées inoubliables ». Il découvre avec enthousiasme et bonheur une vie nouvelle, celle dont il rêvait peut-être secrètement ? L’émotion de voir Dreyfus, bien sûr, à la première apparition duquel il éprouve « le grand frisson » quand il proteste de son innocence, mais aussi Mme Dreyfus qui le reçoit « comme une sorte de parent honoraire ». Et puis Jaurès qui lui a demandé de « descendre » chez lui, et qui le traite « comme un ami et comme un frère ». La maison du Gros-Chêne (aujourd’hui Maurepas) est devenue un haut lieu du dreyfusisme : « il se tient chez moi des conciliabules entre Jaurès, Mathieu, Labori et Lazare ». Aux côtés de ceux qu’il appelle « des hommes admirables qui sont l’honneur de l’humanité », il a le sentiment de vivre au plus près de l’événement qui est à l’origine de son engagement.
Le procès terminé, et mal, puisque Dreyfus est à nouveau condamné le 9 septembre 1899, Victor Basch ne reviendra pas à sa vie paisible d’avant. Cette période de sa vie l’a changé pour toujours. En 1901, il écrit à Zola : « Beaucoup d’entre ceux que le drame de l’Affaire avait bouleversés sont revenus à leurs lâches quiétudes de savant ou d’artiste. Mais tant que des êtres qui nous valent mille fois, sont écrasés sans défense, par la meule sociale, nous avons le devoir sacré de lutter, par la parole, par la plume, par toutes les armes dont nous disposons. »
Loin d’être finie avec l’Affaire, qui resta pour lui le modèle mythique de tous les combats à mener pour la justice et pour la vérité, comme il aime à le répéter « Partout où il y a une injustice, il y a une affaire Dreyfus », l’histoire des engagements de Victor Basch ne fait que commencer. Ces engagements, c’est toujours au sein de la Ligue des droits de l’homme qu’il les vivra, se définissant, de façon éloquente, comme « ligueur, rien que ligueur, depuis toujours et pour toujours. »
Ayant quitté Rennes en 1906, après sa nomination en Sorbonne, il fut bientôt membre du comité central, puis du bureau national, puis vice-président de la Ligue, il en devint enfin le président en 1926, succédant à Ferdinand Buisson. En un temps où la LDH, forte de ses quelque 180 000 adhérents, était une organisation de masse, si essentielle dans le paysage politique et citoyen français que Léon Blum la qualifia un jour de « monument constitutif de la République », Victor Basch fut ainsi de tous les combats importants de l’époque, qu’il s’agisse des droits de l’individu ou des droits des peuples, de la défense de la démocratie ou de la défense de la République.
Réfugié à Lyon à partir de 1940, il fut assassiné le 10 janvier 1944, alors qu’il est âgé de plus de 80 ans, avec sa femme Ilona, par la Milice et la Gestapo lyonnaises, qui signèrent leur acte de ces mots : « le Juif paie toujours. »