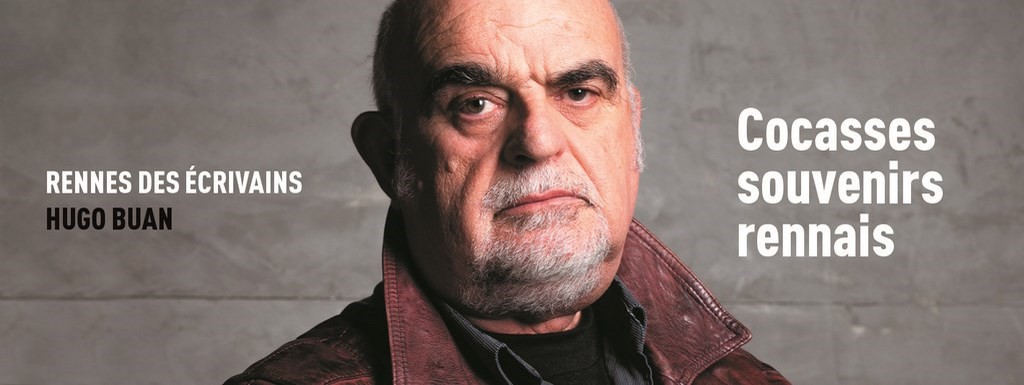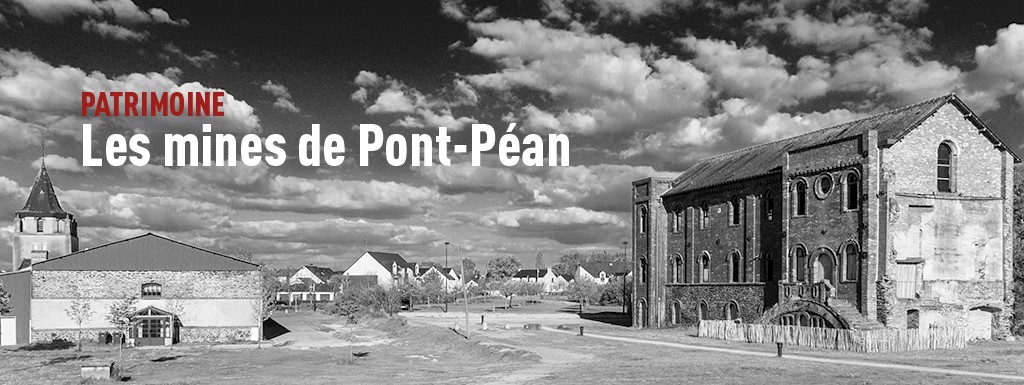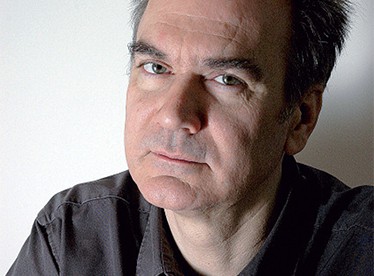
une affinité naturelle
« J’étais avec Raymond
qui m’a dit mon colon
il faut que tu constates
qu’y a rien comme la rue Watt. »
chante Boris Vian. Qui est ce Raymond sinon Queneau, qui lui aussi chantera la rue Watt? Queneau amoureux de Paris, l’auteur de Courir les rues, qui plonge sa Zazie dans le métro. Queneau, au début de Courir les rues, place en exergue une phrase (en grec) qu’il attribue, citant Heidegger, à Héraclite (elle est en fait d’Aristote): « En ce lieu aussi, en effet, les dieux sont présents. » Quel lieu? La ville. Quels dieux? Gageons qu’il s’agit de ceux, moins improbables que d’autres, de la poésie et du langage.
Lisons les oulipiens. Rares sont ceux qui n’ont pas fait de la ville – comme telle – le centre d’un de leurs livres. Soyons, sinon exhaustifs, du moins précis: Italo Calvino s’intéresse à La Spéculation immobilière, aux Villes invisibles, et sous-titre Marcovaldo « Les Saisons en ville ». Perec, avec son ambitieux projet Lieux, qui englobait des travaux comme Espèces d’espaces ou l’expérience infra-ordinaire de l’Epuisement d’un lieu parisien. La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le coeur des humains est le long titre d’un recueil poétique de Jacques Roubaud (dont le titre est une variation sur un vers célèbre des Tableaux parisiens de Baudelaire), d’un Roubaud qui a déjà brûlé une capitale dans Le Grand incendie de Londres. Jacques Jouet fait des Poèmes de métro, D’autres, comme François Caradec, s’intéressent aux Nuages de Paris, d’autres imaginent des Cités de mémoire ou collectent un Herbier des villes.
Pour l’Ouvroir, l’acte d’écriture, comme l’acte de lecture, ne se divise pas et ne s’est jamais limité à la forme traditionnelle du livre. Non seulement tout, pour le groupe, peut être sujet de littérature, mais tout peut être support de littérature: les murs, les colonnes, les trottoirs, les fenêtres, et bien sûr les bancs publics… Les bancs d’Excideuil, de Jacques Jouet (« projet de ville » dans lequel chaque banc – une vingtaine – se voit orné d’un poème) est un des multiples exemples des incursions d’un oulipien dans le territoire citadin, trop nombreuses pour être toutes citées ici.
Pourquoi une telle fascination pour la ville? Il ne saurait y avoir de hiérarchie linéaire des explications pour un espace urbain qui ne l’est pas. Proposons ici une simple exploration des affinités naturelles entre l’Oulipo et la ville. Certes, la cité est saturée de signes. On n’imaginerait pas une ville sans écriture (et – digression – il n’est plus grand désarroi pour un occidental qu’une ville chinoise rayonnante d’idéogrammes) et rien n’est plus tentant que le détournement d’un univers de signes. Mais parce que l’espace maillé et combinatoire d’une ville est à la fois graphe, géométrie et topologie, la ville est aussi mathématique, fût-ce à l’insu de ses hôtes. C’est cette potentialité de la ville, son « tissu urbain » qui fascinent l’Oulipo.
La ville, dans l’écriture oulipienne, romanesque ou poétique, peut être terrain de jeux, territoire à paver ou métaphore du monde, mais elle n’est jamais un simple décor. On le sait, il n’y a pas de discours théorique de l’Oulipo sur la littérature et l’esthétique. Il n’y en aura pas non plus sur la ville ou l’architecture. L’Ouvroir aborde la Ville comme le lieu possible d’une convergence entre poétique et politique : la poétique conçue comme un écart, comme un étonnement, comme un jeu. Le politique perçu comme une exigence de lien social, comme une demande de collectif, comme une interrogation sur la place que nous occupons dans le monde. Ce tissu qui maille étroitement poétique et politique est bien sûr celui qui relie tous les hommes entre eux, le langage. Et l’Ouvroir de littérature potentielle ne saurait oublier l’étymologie commune des mots tissu et texte.
Toute ville est un parcours. L’oulipien en fait le théâtre de trajets multiples et imprévisibles, qui ne deviennent pas toujours des destins, mais toujours des poèmes, des romans, des fragments. « Il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations », disait Nietzsche, et sans doute n’y a-t-il pas de villes, mais seulement des parcours dans celles-ci. Et parce que l’Oulipo est justement l’Oulipo, tout parcours doit obéir à des règles: ainsi, dans le Grand incendie de Londres, Jacques Roubaud dit avoir « un goût très vif pour les parcours obligés, où l’itinéraire, non prévisible à l’avance au sens où je ne le connaîtrais pas, est néanmoins nécessaire, dès lors que la ou les règles qui guideront mes pas auront été par moi choisies.
Ces règles peuvent être très contraignantes, absurdes, bizarres ; pour m’en tenir ici à la ville, je peux décider de n’avancer qu’en empruntant des rues à nom de lieu, par exemple (c’est particulièrement facile dans le quartier de Saint-Lazare, le mien autrefois, où elles abondent), ce qui m’amène parfois à des culs-de-sac (en ce sens) d’où je ne peux me sortir que par un coup de force, un « clinamen ». »
Toute ville est un organisme vivant, avec ses organes, ses flux, ses rythmes, et même ses déchets. Et d’une bouteille d’eau ramassée dans un caniveau, pourquoi ne pas faire un haïku: « Toute l’eau du monde/a été pissée sept fois/par un dinosaure ». Mais une poésie de la ville peut aussi se vouloir mimétique, et le poème L’heure de Roubaud doit alors se lire comme une horloge de phrases qui sonnerait les moments des rythmes sourds de la ville.
« l’heure du réveil des habitants du passage de la reine de hongrie
l’heure de l’ouverture du café de la rue du moulin de la pointe
l’heure du ramassage des poubelles de la rue du sommet des alpes
l’heure de l’ouverture de la boulangerie de la rue du roi de sicile
l’heure de l’extinction des réverbères de la rue du pot de fer… »
Toute ville est une utopie. Calvino, dans Marcovaldo, construit pour y loger son héros une ville indéterminée. Mais il précise : « Cette indétermination est certainement voulue par l’Auteur pour signifier que ce n’est pas une ville, mais la ville, une métropole industrielle quelconque, abstraite et typique, de même qu’abstraites et typiques sont les histoires racontées. » Calvino ira plus loin encore dans Si par une nuit d’hiver un voyageur où, s’amusant à décrire une gare, il la suspend dans l’espace littéraire. Elle tient par quelques mots, un « sifflement de piston couvre l’ouverture du chapitre, la fumée cache en partie le premier alinéa », fusion parfaite d’un bâtiment de la langue, de l’univers de la brique et de celui des mots. Lacunaire, la ville voit toujours ses manques comblés par l’imagination du lecteur, et le verbe triomphe ici de l’image.
Toute ville est un imaginaire de mots. On ne s’en étonnera pas: l’oulipien prend toujours la ville au mot. Il y a chez lui un amour cratylien faussement naïf. Dans « Rue Madame et Monsieur », de Jacques Roubaud, deux piétons de sexe opposé empruntent des chemins bien séparés: « Jamais ell’n’alla par la rue Madame/Jamais il n’alla par la rue Monsieur/Leurs yeux jamais ne s’lancèrent de flammes/Leurs bouches jamais n’échangèrent de voeux// Après tout cela vaut peut-être mieux. » Un autre exemple? Au coin de la rue Sarrette dans le 14e (Bernard Sarrette, Bordeaux, 1765 – Paris, 1858), fondateur du conservatoire de Paris, Olivier Salon s’interroge, perplexe, devant la caméra d’Odile Fillon: « Qui dira pourquoi la rue Sarrette? » Un peu plus tard, devant le même objectif, il endosse moufles et anorak en plein juillet (accompagné dans son expédition par Coraline Soulier) pour affronter la rue du Pôle Nord.
Toute ville, enfin, est une mémoire stratifiée. Elle n’oublie rien des siècles de son histoire, même si, comme dit Queneau, « le Paris que vous aimâtes n’est pas celui que nous aimons ». Ici, un amphithéâtre romain, là, une église gothique, une pagode japonisante, là, un pont d’acier que conçut un élève d’Eiffel, ici, un haut immeuble de béton des années 50, ici une pyramide égyptienne, mais de verre et d’acier. Non, la ville n’oublie jamais tout à fait. Sa forme change, comme l’écrit Baudelaire, mais elle abandonne peu. L’Oulipo, qui ne fait table rase de rien, qui puise son inspiration chez les Grands Rhétoriqueurs et ne rechigne pas devant l’imitation d’un haïku d’Issa, obéit aux même logiques. Et l’Ouvroir qui n’oublie pas (mais oublie quand même parfois) aime à jouer avec l’oubli de la mémoire collective. Car l’habitant de la ville, lui, oublie. Qui se souvient, non seulement de qui fut Paul Escudier, mais de l’origine du nom de la place Blanche?
L’Oulipo, lorsqu’il propose au citadin de fausses toponymies, perturbe le bel ordonnancement de la ville endormie. Voici, par exemple, la suggestion oulipienne pour la station de tramway Étoile, à Strasbourg: « ÉTOILE, lieu-dit. C’est à cet endroit qu’en 1534 le jeune Galilée (Galileo Galilei, dit) observa pour la première fois les satellites de Jupiter et la rotation du soleil. L’exploit de l’astronome est d’autant plus admirable que Galilée n’a jamais séjourné en Alsace et qu’il est né en 1664, à Pise. » Le lecteur peut donc légitimement douter de ce qui est écrit, et le doute, qui fonde la science, n’est-il pas le début de la sagesse? Car on aurait tort de croire que ce jeu est sans effet. Les diversions oulipiennes sont un refuge pour l’imaginaire, un lieu de liberté (pardon pour ce mot galvaudé). Et l’art vient donner (rendre?) à la vie une dignité.
Tout jeu dans la ville, sur la ville, devient alors un jeu sur la mémoire collective, un jeu sur ce patrimoine enfoui sous les noms des voies, des jardins et des monuments, des stations de bus ou de métro. Car si la ville est pleine à craquer de signes, elle possède ceci de commun avec le langage qu’elle a laissé s’installer en son sein des zones « cuites », dont les genèses, avec le temps, ont été oubliées : l’intervention oulipienne soulève une interrogation, un doute, qui, sans démagogie et même sans pédagogie, poussent chacun à questionner sa place dans la cité. L’encre fait ici ancre. C’est une définition possible de la politique.
L’Oulipo dit simplement ceci : parce que l’écriture est au coeur de la ville, que la ville peut se lire comme un livre, on peut y faire pénétrer un texte qui ne soit ni utilitaire, ni publicitaire. Il y a donc de la civilité dans la contrainte, une réelle urbanité, au double sens du mot. On peut faire vivre dans la cité un texte qui joue avec le regard, le coeur et l’intelligence, qui les accroche, les étonne, les retient. On peut y faire naître une oeuvre lisible, immédiate et étrange, qui voudra égarer, perturber l’ordre policé, dessiner une faille, un écart. C’est une définition possible de la poétique.
C’est par son miracle, car ces dieux dont parle Héraclite (ou Aristote) en accomplissent, que, parvenu au cinq de la rue Volta, le lecteur de Queneau se souviendra qu’il y eut ici une petite échoppe ancienne,
« rareté électricienne,
dont le nom s’égara là,
garala garala
garala pile à Volta. »