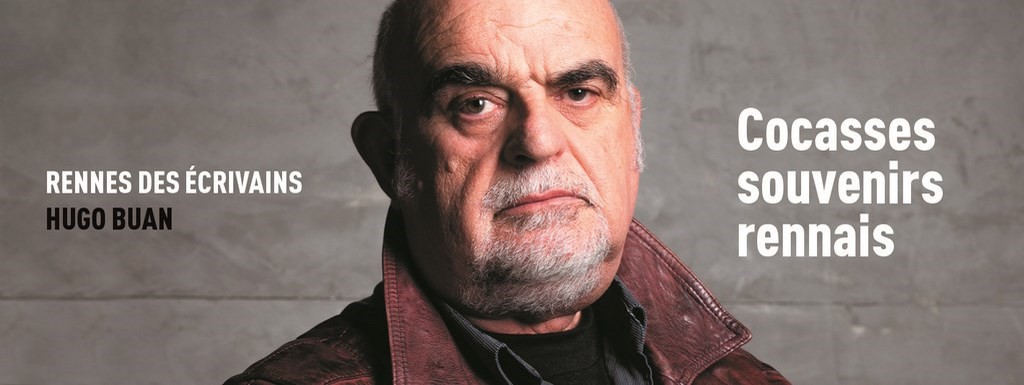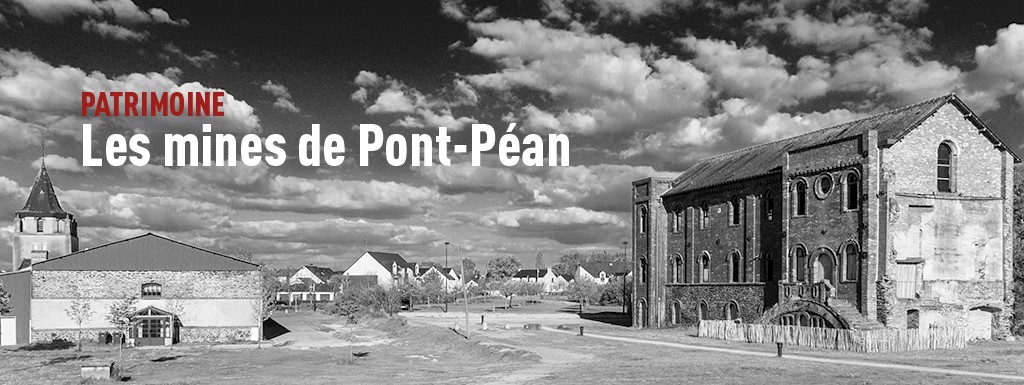« J’avais 18 ans, l’année universitaire 1955 commençait mal… »
Colette Cosnier (suite)
Colette Cosnier est l’auteur de nombreux ouvrages. Retenons deux livres de fictions : Le Chemin des salicornes, roman paru chez Albin Michel en 1981 et Les Gens de l’office, aux éditions Cénomane, 1993.
L’auteure est surtout connue par ses biographies de femmes, voire de féministes : ainsi Marie Bashkirtseff, un portrait sans retouches (Horay, 1985). Ou encore la vie d’une Rennaise : La Bolchevique aux bijoux : Louise Bodin , (Horay, 1988). Celle d’une Fléchoise : Marie Pape-Carpantier, fondatrice de l’école maternelle, (Fayard, 2003). Et enfin : Henriette d’Angeville, la Dame du Mont-Blanc, (Guérin, 2006). On doit aussi à Colette Cosnier des pièces de théâtre dont Marion du Faouët, la catin aux cheveux rouges ( Oswald, 1976), un essai : Le Silence des filles. De l’aiguille à la plume, (Fayard, 2001) et des livres d’histoire : Rennes et Dreyfus en 1899. Une ville, un procès, co-écrit avec son mari André Hélard (Horay, 1999), ouvrage qui obtint le Prix des Écrivains de l’Ouest 1999. Elle est aussi l’auteur de Parcours de femmes à Rennes, en collaboration avec Dominique Irvoas-Dantec, (Apogée, 2001). Le dernier livre paru de Colette Cosnier est Les Dames de Femina. Un féminisme mystifié, en 2009 aux Presses Universitaires de Rennes.
D’abord, il y avait la passerelle. Une passerelle enjambant la gare depuis la place et aboutissant à la rue Bigot de Préameneu qu’elle abordait grâce à une sorte de couloir rétréci et à angle droit, parfaitement sinistre à la nuit tombante. Certes, cela évitait de faire un grand détour par le pont de l’Alma: « d’ici à la place Hoche, c’est tout droit à vol d’oiseau » disait ma logeuse. Malheureusement, je n’étais pas un oiseau. Emprunter la passerelle lorsque dessous passait un train, crachant, hoquetant, sifflant une fumée puante qui m’aveuglait était une épreuve à laquelle je ne pouvais pas m’habituer. On était à l’époque des trains à charbon, grands distributeurs d’escarbilles. Cela tenait du dragon et de La Bête humaine.
Ensuite, il y avait la pluie. Ou plus exactement ce qu’on appelait du crachin. Il ne pleuvait pas assez dru pour laver la passerelle où mes chaussures à semelles de crêpe ramenait la boue de la rue Bigot de Préameneu, car les trottoirs n’existaient pas encore.
Il y avait aussi ma logeuse. J’ai compris plus tard qu’elle n’était pas un modèle unique à moi réservée, hélas ! En fait, « la propriétaire rennaise » qui ne louait qu’à des étudiantes était une espèce particulièrement redoutable et très répandue. La mienne déplorait que je me sois inscrite en Lettres: « ce n’est pas là qu’il faut aller pour trouver un mari. » Ce en quoi, comme en d’autres choses, elle s’est trompée!
Les choristes du Restau U
Enfin il y avait le restaurant universitaire, « le restau U » de la rue de Fougères, son odeur de graillon et son vacarme organisé par les étudiants en médecine, ce qui nous valait de manger du « rôti de porc, riz à l’indienne », (à moins que ce ne fût du « rôti de porc, riz à l’espagnole ») au son des Filles de Camaret, et d’essayer d’avaler, sur fond sonore de Maman qu’est-ce qu’un pucelage? le hachis Parmentier où les choristes paillards prétendaient reconnaître morceaux de gras ou de peau qu’ils avaient laissés la veille sur leur plateau.
Quant à la fac, celle qui était située place Hoche, c’était vite vu: un bâtiment sans intérêt, des salles de cours sinistres, des amphithéâtres qui avaient beau porter les noms de Renan et Chateaubriand, mais qui décourageaient toute sympathie, avec leurs pupitres mal commodes et leur foule d’inconnus.
J’avais 18 ans, l’année universitaire 1955 commençait mal. Il me manquait ma famille, ma ville, ma maison, mon jardin, mon chat, ma rivière, mon lycée et ma classe de philo où nous étions douze, six garçons, six filles, pratiquant sans le savoir la parité. Le tout en Sarthe. Normalement, si j’avais fait comme les autres, après le bac, je serais partie à l’université de Caen, mais j’avais préféré Rennes parce que j’aimais la Bretagne. Ma Bretagne, c’était la presqu’île guérandaise. Pas Rennes, où la seule chose qui me faisait penser au pays breton, c’était le magasin de souvenirs de l’avenue Janvier qui vendait les mêmes bolées Henriot ou HB qu’on trouvait dans les bazars du Croisic.
Je boudais Rennes…
Des regrets, des larmes… je boudais Rennes qui me le rendait bien. Qui, d’elle ou de moi a fait les premiers pas? Je ne sais plus. Ma vieille mémoire a oublié plein de choses, mais comment a-t-elle fait ce tri ? Car elle a trié dans ces années de vie rennaise comme si elle ne voulait pas garder trace de ma tristesse, comme si elle jugeait inutile de conserver le souvenir des cours de philologie de l’ancien français ou de l’art du conte selon Maupassant. Ce n’est pas la peine d’espérer un récit bien construit, bien documenté, 1955 : rien ne va, 1956 : tout va mieux, 1957 : tout va bien, 1958 : tout va très bien etc., pour arriver en 1963 avec ma soutenance de thèse, apothéose et feu d’artifice devant la grande porte de la Faculté des Lettres, sonnerie de trompettes et carillons, tandis qu’une voix off m’aurait interpellée solennellement : « entre ici, Colette Cosnier, l’université t’accueille en son sein… » Évidemment, cela ne s’est pas passé comme cela.
Que reste-t-il de ces années où j’ai quitté une adolescence prolongée, et où Bécassine sarthoise, j’ai découvert qu’il existait une autre vie? Disons le temps qu’il m’a fallu pour troquer mes chaussures à semelles de crêpe contre des talons hauts, dont beaucoup périrent coincés entre les dalles de granit des trottoirs de la rue Hoche.
Un sonneur de biniou invisible
Certes, je pourrais retrouver sans problème le souvenir des cours, des profs et de leurs auditoires, mais ce n’est pas ce que je cherche. Ma mémoire ne me fournit que des miettes, des flashes, des visages, des lieux, des événements, au hasard, sans se soucier de la chronologie. Tant pis, allons-y : visages sans nom, événements sans dates, voix oubliées. C’est un puzzle, un kaléidoscope: un sonneur de biniou invisible, rue Edith-Cawell, s’exerce non sans mal à jouer L’adieu à la baie de La Baule; en dépit du crachin, place de la République, les passants ne se hâtent pas, ils restent même assis, « il fait doux » dit ma logeuse; en mai, l’avenue Janvier, le Champ-de-Mars prennent des airs de comice agricole, envahis par les gens de la campagne venus pour la « Foire de Rennes, reine des foires », ils déballent leur repas sur de grandes tables flanquées de bancs comme on voit dans les fermes ; devant l’immeuble Ouest-France de la rue du Pré-Botté on entend « C’est magnifique! » chanté par Luis Mariano; au bas de la rue d’Orléans, des femmes vendent des bouquets de jonquilles; dans la cour de la fac, les beaux jours ramènent le « fou » qui se sauve parfois de l’asile de Vitré pour revenir dans ce lieu où il a sans doute étudié autrefois, on fait cercle autour de lui pour l’entendre réciter une page de Cervantès ou expliquer la différence entre le verbe ser et le verbe estar, et les hispanisants constatent qu’il ne se trompe pas ; dans certains magasins de la rue de Toulouse ou de la rue Nationale, on ne sait pas exactement, on ne s’aventure qu’à plusieurs filles, car la rumeur publique les accuse de se livrer à la traite des Blanches, et malheur à celle qui s’aventure dans une cabine d’essayage; à la cité universitaire des garçons où on passe la visite médicale, l’infirmière clame : « mesdemoiselles les étudiantes, dans les déshabilloirs! Messieurs les étudiants, silence! » ils gloussent alors en voyant les filles se diriger, un verre à la main, vers l’analyse d’urine; le snack-bar Holleywood propose « ses boissons saines dans un cadre plaisant »; un étudiant du nom de Louis Le Pensec a fondé une faculté de Folklore et Sciences Hilares ; les cathos, ou les amateurs de traditions, portent des faluches hérissées d’insignes et d’écussons; dans les Salons Gaze a lieu le bal des Sciences ou celui du Droit; on aperçoit parfois, à la section d’anglais Robert Merle qui a eu le prix Goncourt pour Week-end à Zuydcoote, un roman aux scènes d’une violence insoutenable, dit-on, mais ce n’est rien à côté de son dernier livre, Oscar Wilde ou la « destinée » de l’homosexuel, qui scandalise ceux qui n’osent pas prononcer le mot et baissent la voix pour parler d’une thèse consacré à un pédéraste; rue Hoche, vient de s’ouvrir un milk-bar qui sert d’étranges boissons glacées qu’on appelle des milk-shake ; il y a depuis peu trois femmes professeurs, un de leurs collègues les nomme la Rance, la Seiche et la Vilaine… cela fait beaucoup rire.
Le ciné-club de Jean Sulivan
Mais peu à peu, Rennes-Passerelle, Rennes-Crachin et Rennes-Restau U ont perdu leurs pouvoirs maléfiques. L’air sent bon le doux tabac Amsterdamer, au club de littérature comparée on boit de l’yerba maté qui vient tout droit du Brésil. Et on parle, on parle… S’il n’y avait pas les cours on irait au cinéma tous les jours : au Ciné- Club de l’A (Association Générale des Étudiants Rennais), on voit Charlot cambrioleur et Charlot concierge, le projecteur est au milieu de la salle parmi les spectateurs, il faut changer plusieurs fois de bobines, et souvent c’est la panne. On en profite pour se raconter le Charlot de la semaine dernière. La Chambre noire ignore ces fantaisies: nous sommes au Français, au Paris, Jean Sulivan (l’abbé Lemarchand) présente le film, il s’emporte, s’exalte, s’indigne, nous houspille, nous fait honte de notre conformisme petit-bourgeois. Nous sortons de là repentants et enthousiastes: il nous a donné Bergman et Visconti, Renoir et Bunuel. Et il nous a appris à les lire. Du coup, nous faisons la fine bouche devant les films commerciaux, je boude le Royal, et je n’irai pas voir Violettes impériales.
L’autre haut-lieu de mes découvertes, c’est le théâtre. Un vrai, rouge et or, avec un plafond où dansent des bretons: le Théâtre Municipal, place de la Mairie. Après un rude escalier on atteignait le poulailler, où souvent, on ne restait que le temps du premier acte, debout on guettait les places libres à l’orchestre pour s’y précipiter dès l’entr’acte. C’est là que la CDO (Comédie de l’Ouest) donne ses représentations : Les Femmes savantes portent des costumes modernes et Trissotin écoute un transistor. Dans la rue, je croise le metteur en scène Guy Parigot ou Maurice Barrier qui va devenir le prince de Hombourg. Mais comment exprimer l’émotion qui est la mienne lorsque Tsilla Chelton vient jouer Les Chaises d’un auteur inconnu, Eugène Ionesco, j’en perds le souffle, ma gorge se noue, j’ai chaud, je tremble au fur et à mesure que la scène est envahie par des chaises vides.
La grande et la petite « nourrice »
C’est un choc du même ordre qui s’est produit lors de ma première visite aux Nourritures terrestres. Encore n’avais-je pas osé y entrer tout de suite alors que je cherchais une librairie, ce n’était pas possible d’acheter là les Pensées de Pascal. Dans la vitrine, il y avait les Exercices de style de Raymond Queneau, grand ouvert sur la page « Injurieux »: « dans une autobus immonde où se serrait une bande de cons, le plus con d’entre ces cons était un boutonneux »…Oui, il m’a fallu un peu de temps pour entrer chez les Nourrices, comme les appelaient leurs fidèles. Mais du jour où j’ai poussé la porte… tout a été dit sur la cheminée, les livres entassés, les photos d’écrivains, la voix de la Grande Nourrice houspillant le fasciste qui voulait une histoire de la guerre d’Espagne favorable aux franquistes : « dehors ! dehors ! Monsieur, vous ne trouverez pas cela chez nous ! », me conseillant aussi bien Les Souris de l’église que le Journal d’Anaïs Nin ou Orlando de Virginia Woolf mais refusant de me vendre le dernier prix littéraire: « non! je ne peux pas vous vendre Ça! c’est trop mauvais… achetez-le ailleurs, mais pas ici! » Et la petite Nourrice opinait, non ce n’était pas possible, et l’époux de la Grande racontait une de ses visites chez Gallimard… Faut-il préciser qu’une de mes plus grandes joies sera un jour de 1977 où j’ai reçu d’elle une carte m’annonçant « votre roman vient d’arriver ! Nous l’avons mis dans la vitrine! »
Années 60 : Rennes rajeunit
Peu à peu, Rennes et moi, nous avons changé. Je vieillis? non, on ne vieillit pas à 20 ans et on ne grandit plus. On mûrit. Quant à la ville, elle rajeunit plutôt. On ne parle que du scandale causé en 1960 par la représentation au Théâtre municipal de Boulevard Durand d’Armand Salacrou: la mise en scène prévoyait que les comédiens entonnent sur scène L’Internationale mais personne n’avait imaginé que le poulailler se joindrait aux choeurs et qu’une partie de la salle se lèverait en chantant: « C’est la lutte finale! » Les bizutés qui offusquaient les bourgeois de la rue Le Bastard en criant « les cocus au balcon! » ont cédé la place aux manifestants contre la guerre d’Algérie, et à ceux qui tiennent meeting aux Lices contre la réduction du taux des bourses, le journal de L’A salue « la vitalité du Syndicalisme étudiant » et exprime ses craintes à propos de la résiliation des sursis qui risque bien d’envoyer au service militaire tous ceux qui espéraient pouvoir finir leurs études. L’auteur de l’article s’inquiète: « Remplir les casernes… en ne laissant que des filles en fac? »
Décidément, il allait être temps de découvrir Simone de Beauvoir. Mais ce sera une autre histoire.