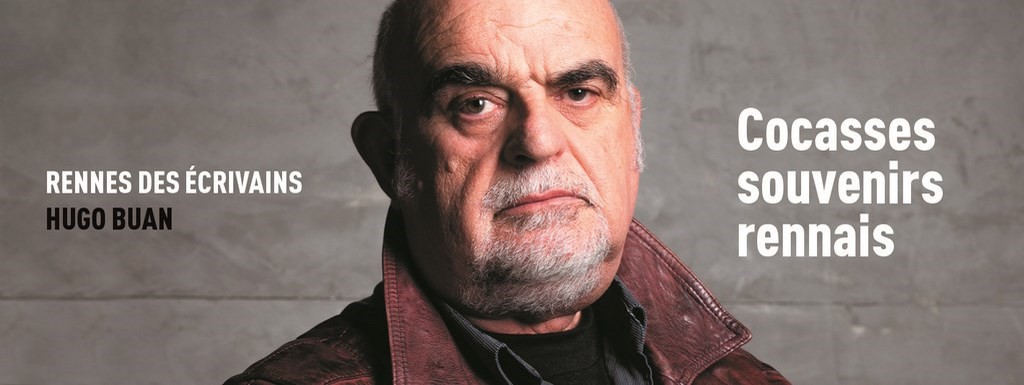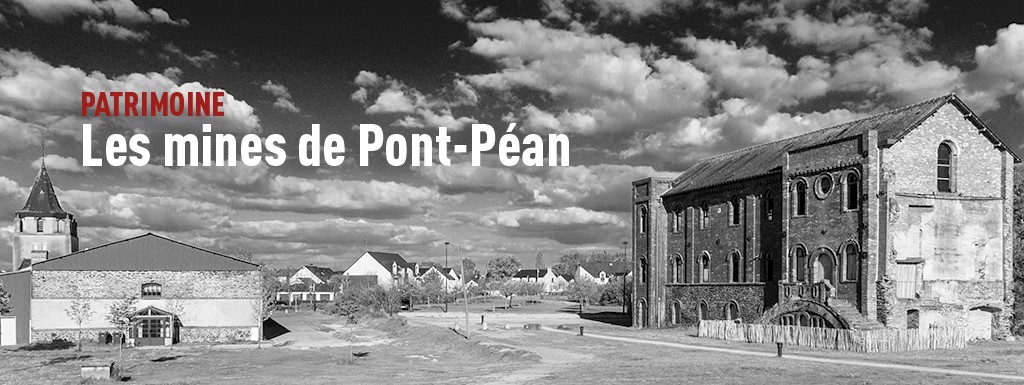de janvier à janvier
Éric Pessan (suite)
Le roman n’épuise pas la créativité d’Éric Pessan. Dans sa besace on trouve aussi des nouvelles, des textes écrits « en compagnie » de plasticiens, des fictions radiophoniques, des pièces de théâtre, des livres pour la jeunesse, des recueils de poésie, des essais, des livres d’artistes, des livres de dessins…
Ce travail d’écriture s’accompagne chez Éric Pessan d’un rôle d’« activiste » littéraire mené dans le « monde réel ». Il a dirigé l’éphémère revue nantaise Éponyme et se trouve aujourd’hui membre du comité de rédaction du site littéraire en ligne Remue.net ainsi que de la revue Espace(s) du Centre National d’Études Spatiales. L’activité de l’écrivain nantais l’amène aussi très souvent à animer des rencontres littéraires et des débats ainsi que des ateliers d’écriture, un peu partout en France.
Pourquoi inviter ce Nantais à écrire dans le « Rennes des écrivains » ? Parce qu’Éric Pessan est un habitué de la ville. Pour la deuxième année consécutive, il est en résidence au Triangle, le centre culturel du Blosne. Durant ces « cartes blanches », l’écrivain propose des rencontres, des ateliers, des soirées, comme en octobre dernier où avec la comédienne Marion Bottolier, il présenta une « lecture dessinée performée » sous le titre de « Parfois, je vis la vie d’un écrivain ».
Quand il est arrivé au Triangle, en janvier 2015, le jour même où il s’installe, tombent les nouvelles du massacre de Charlie et ensuite de l’Hyper Casher. Comment oublier ? Un an après, dans ce numéro de Place Publique, Éric Pessan évoque ce drame qui visait la libre expression et le métier même d’écrire. Un métier qui fut aussi particulièrement productif en 2015 puisqu’Éric Pessan a publié sept livres durant l’année, tel un bras d’honneur à l’horreur des tueries ! Le démon avance toujours en ligne droite, déjà cité, Aussi loin que possible (roman jeunesse, l’École des Loisirs), Cache-cache (théâtre, l’École des Loisirs), En voie de disparition (récit-poème, Al Dante), Le monde et l’immonde (récit, Éditions du Musée d’histoire de Nantes), La hante (avec Patricia Cartereau, l’Atelier Contemporain) et enfin Parfois, je dessine dans mon carnet (dessins, Éditions de l’Attente).
1990, 1991, je ne sais plus. C’est ma toute première venue à Rennes, Peter Hammill passe à l’Ubu. Si mes souvenirs sont bons, il s’agit d’un concert unique en France. Nous sommes une cinquantaine réunis dans le club à écouter religieusement l’homme qui a gardé ses pantoufles sur scène. Peter Hammill a fondé à la fin des années 60 le Van der Graaf Generator, a influencé Peter Gabriel ainsi que toute une génération de musiciens avant – il faut bien l’avouer – de tomber un peu dans l’oubli. Le concert est généreux, à la fin Hammill viendra s’installer parmi ses fans pour discuter tranquillement d’une époque qui n’est plus.
Mercredi 7 janvier 2015. Je m’installe dans le hall du centre culturel Triangle, je dois commencer un travail : j’ai prévu d’interroger les usagers du lieu, de les questionner sur la représentation qu’ils ont du métier d’écrivain. En échange de leur réponse, je fais un dessin. Je suis installé à une table avec mon ordinateur. Des gens patientent devant la porte close de la bibliothèque, des collégiennes me regardent et détournent les yeux quand je les regarde en retour. Je suis groggy, j’ai passé les deux heures précédentes sur les réseaux sociaux et les sites d’information à tenter de savoir ce qui s’est déroulé à 11 h 30 dans les locaux du journal Charlie Hebdo. J’ai l’esprit ailleurs, je garde sur un coin de l’écran le fil d’actualité du journal Le Monde.
Un petit spectacle de danse commence dans une demi-heure. Des gens viennent me voir, on discute, dans la fenêtre de mon ordinateur, je vois passer le nom de Cabu, celui de Charb.
Des enfants dansent, j’entends des rires, je vois une mère s’éloigner, son très jeune fils en pleurs dans ses bras. Les rires se mêlent aux conversations, bientôt couverts par les tambours de la danse.
Le bilan s’est alourdi. Des enfants me parlent, j’apprends à un homme ce qui s’est produit et je n’aime pas incarner celui qui dit. Ce qui devait être une première prise de contact avec le public du Triangle n’en est pas une, le monde a fait écran, le monde ne permettait rien d’autre aujourd’hui que d’avoir l’œil hypnotisé sur un fil d’actualité, le cœur tapant, les pensées blanches et creuses, et la conviction de se tenir en équilibre sur le seuil de la catastrophe.
Fin 1989. J’emménage à Nantes. Je viendrai, année après année, assister à un concert ou voir un spectacle au TNB à Rennes. À cette époque, j’écris et n’en parle à personne. J’ai trop vu de gens de mon âge se vanter de vouloir devenir réalisateur, comédien, artiste ou écrivain. J’anime des émissions sur une radio associative. Début 1996, ce qui était un loisir deviendra une profession. Directeur d’antenne d’une radio nantaise, Jet FM, je couvrirai chaque année les Transmusicales. Rennes sera alors la nuit, le village pro installé en face du Liberté, les interviews de groupes, les badges autour du cou et les longues fatigues heureuses à la fin de chaque édition.
14 janvier 2015. Stromae chante qu’il est formidable, le hall est désert, des pompiers passent et vérifient les normes de la signalisation de sécurité. Je relis mes notes de mercredi dernier, j’ai l’impression qu’elles datent de plusieurs mois. Certaines semaines en contiennent dix, vingt, mille. J’ai pris des trains, j’ai rencontré des gens, j’ai signé des pétitions, j’ai écrit, j’ai animé des ateliers, j’ai expliqué l’intégrisme à mon fils, j’ai lu, j’ai peu dormi, j’ai fini par décrocher mon regard des fils d’actualité pour m’offrir la possibilité de penser par moi-même.
La semaine a été superlative : le pire attentat jamais commis, la plus grande mobilisation jamais connue, la plus intense horreur et la plus immense solidarité. La semaine a été celle de tous les débordements. Toutes les émotions, toutes les fraternités, toutes les abjections. La semaine m’a épuisé, elle m’a vieilli.
Je suis ici pour questionner le travail de l’écrivain ainsi que pour mener à bien le commencement d’un travail personnel dont le thème est « comment le fait social s’imprime sur l’intime de l’individu ». Lorsque j’ai pensé à ce projet – au printemps dernier – je voulais parler de mon propre désarroi face à la chose politique. Je voulais dire à quel point la perte des convictions me plongeait dans un état doucement dépressif. Je voulais faire ce que je fais toujours : offrir mes troubles à un personnage de fiction, non pas pour m’en débarrasser, mais pour les partager, les interroger, les transformer en littérature. J’ignorais à quel point mon « sujet » allait devenir central. Partout des écrivains et des artistes s’interrogent et se demandent comment agir. J’en viens à remettre mon projet en question tellement il paraît opportuniste.
Les gens arrivent, passent, je commence à poser des questions. Être dans l’action maintient les doutes à distance. Alors, comment voyez-vous le travail d’un écrivain ?
Une heure trente plus tard, je relève la tête et vois trois policières, armes à la ceinture, qui s’approchent pour voir ce que je fabrique. Je leur souris, elles me sourient. Depuis une semaine, le rapport à la police a considérablement changé. Depuis une semaine, beaucoup de choses changent.
Septembre 2001. Je publie mon premier roman, je commence à être invité ici et là pour venir parler de mes textes. Je publie un second, un troisième roman, je démissionne de mon emploi parce que je n’arrive plus à mener de front mon travail à la radio, ma vie privée et l’écriture. Des villes que je traverse, je connais souvent la gare, une librairie ou une médiathèque, un hôtel et – si j’ai un peu de temps – un musée, les berges d’un fleuve ou d’une rivière, un monument, un théâtre. Les années ont beau passer, elles ne me transforment pas : c’est à travers le prisme de la culture que je découvre une ville.
21 janvier 2015. J’ai dormi onze heures cette nuit, fiévreux, enroulé dans la couette, avec – comme à chaque fois – des souvenirs d’enfance qui remontent : quand les maladies faisaient événements, qu’aux absences à l’école s’ajoutait la joie d’être l’objet de toutes les attentions.
Cette après-midi, l’équipe du Triangle a installé un petit radiateur à mes pieds, comme un vestige des pré- venances d’autrefois. Je m’installe dans le hall et je me sens fragile, de cette fragilité propre à la maladie : outre la fatigue physique et le mal de tête, c’est comme une acuité glaçante portée aux choses. Ma peau supporte mal mes vêtements et mes yeux supportent mal le monde environnant : il blesse ma rétine, il est trop présent. Le jour d’après la fièvre porte en lui l’illusion d’un apaisement. Troisième semaine de résidence : j’ai commencé l’écriture d’un roman, j’ai également commencé à assembler un texte hybride, une chose imprévue qui était déjà là, dans de multiples fragments, et qui m’est apparue avec une terrible évidence alors que j’ouvrais de vieux fichiers dormant dans le ventre de mon ordinateur. Les idées parfois poussent comme les cheveux. Il est impossible de les voir croître à l’œil nu, puis on se regarde dans le miroir et on voit – un beau jour – combien notre tête a changé. Parfois, l’idée précède le livre, et parfois l’idée donne un sens après coup à ce qui est en cours d’écriture.
2001-2015. Au fil des publications, des projets et des résidences d’écriture, la vie d’écrivain trace une cartographie sensible du pays : dans telle ville on a séjourné quelques semaines, dans telle autre une compagnie a joué notre texte, ici la rencontre en librairie a tourné au fiasco, là c’était noir de monde. Par-dessus la carte de la France se coud une nouvelle carte, subjective, faite de visages, de poignées de mains, de souvenirs, de lieux, d’arrière-salles de bibliothèque où l’on cherche le café comme de self de collèges où l’on pousse son plateau en compagnie des élèves que l’on fait écrire. Des creux subsistent, on n’a jamais été invité ici ou là. On n’en prend pas ombrage, d’ailleurs on refuse parfois le déplacement, par manque de temps, de disponibilité ou – tout simplement – d’énergie.
28 janvier 2015. Hier, en rentrant d’un rendez-vous, je m’arrête au passage des pompiers. À cinquante mètres du Triangle, devant le commissariat, les gyrophares tournent et un attroupement se forme. Je m’oriente dans le sens opposé, je ne veux pas fureter en direction de ce que je suppose être un accident.
Ce matin, j’apprends la cause de cette agitation : un homme s’est présenté au commissariat pour déclarer qu’il avait assassiné son épouse et qu’elle se trouvait maintenant dans le coffre de sa voiture.
Dès la fin de la matinée, les gens viennent me parler du fait divers. Comme s’il y avait là quelque chose qui puisse entrer en résonance avec mes préoccupations. L’écrivain est supposé faire son nid avec les brindilles des drames. Je n’entre pas de force dans ce genre d’histoire. Ce serait facile pourtant, avec un peu d’indécence, de raconter l’alcool ou le coup de sang ou la folie ou la misère qui n’est pas une raison et n’excuse rien. Mais je ne veux pas, je réponds à qui me parle de l’affaire sans renchérir. Je réponds comme un individu ordinaire. Ce serait donc qu’il y aurait une position autre, une réponse d’écrivain ? Une tragédie s’est dénouée à quelques mètres de moi, d’autres se déroulent certainement alentours, derrière des volets ou des bouches closes. Je n’ai pas plus autorité que quiconque d’en parler.
Cette semaine se passe en immersion dans le texte, ou plutôt dans les textes, je passe du roman à cet ensemble de fragments qui se répondent. J’ai une fringale terrible d’écriture et de lecture. Dans le hall, je salue les habitués et les habitués viennent me demander si ça avance. Alors je réponds que oui, ça avance bien que je ne sache pas où je vais, bien que ce qui avance avance dans le désordre. Je tente de lâcher prise, d’écrire et de faire confiance à ce qui s’écrit. Je me dis que je trouverai la forme plus tard, que – comme souvent – au bout d’un moment je comprendrai ce qui est déjà là. Les mômes courent, et certains me saluent d’un « bonjour Monsieur l’écrivain ». Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça, je ne sais pas si tout ça doit servir. Pour l’instant, je le vis.
15 octobre 2015. Je suis revenu au Triangle pour fêter la sortie du livre de fragments. Il a été achevé, publié, il se nomme En voie de disparition. Hier soir, je lisais et dessinais en public avec la comédienne Marion Bottolier. Ce matin, je me promène le long du mélancolique canal Saint-Martin. Des maisons doivent laisser place à un espace vert, les propriétaires organisent la résistance, placardent des appels, refusent l’expropriation. Dans une petite rue perpendiculaire toutes les portes et fenêtres sont murées sauf une où l’atelier de sérigraphie La presse purée fonctionne encore. Je regarde se faire des impressions pour les tirages de tête d’un de mes livres. La plasticienne Patricia Cartereau travaille. J’ai relu mon journal de bord de janvier 2015, parce que cet article paraîtra en janvier 2016. À ce moment-là, mon roman lui aussi sera fini, des célébrations ne manqueront pas d’honorer la mémoire des victimes de Charlie Hebdo et l’atelier de sérigraphie aura déménagé. On m’a montré deux arbres dans le jardin, des néfliers, ils sont classés, protégés. Ce sont peut-être les deux seuls de Bretagne. Quand tout sera rasé, ils seront encore là. Je marche le long du canal, je cherche à savoir ce qui m’émeut à la pensée que si tout ici se transforme, deux arbres resteront, et je me dis que cela tient à la mémoire. On oublie tant de choses, tout se transforme, les émotions refluent et – quelque part – deux arbres restent inchangés.