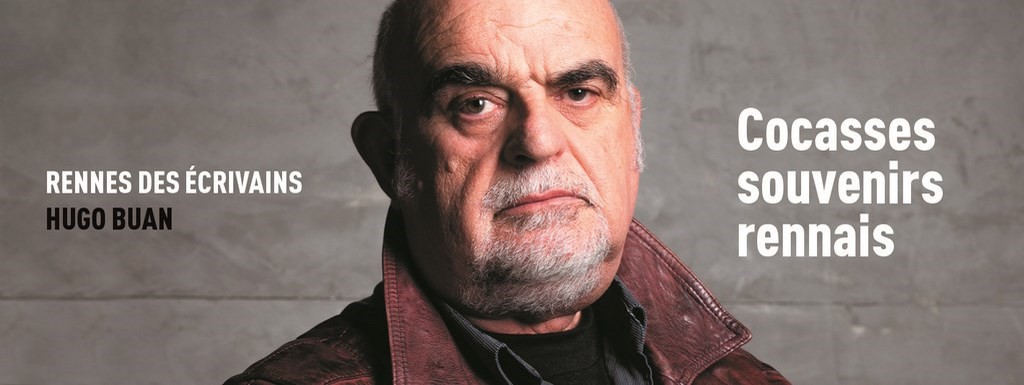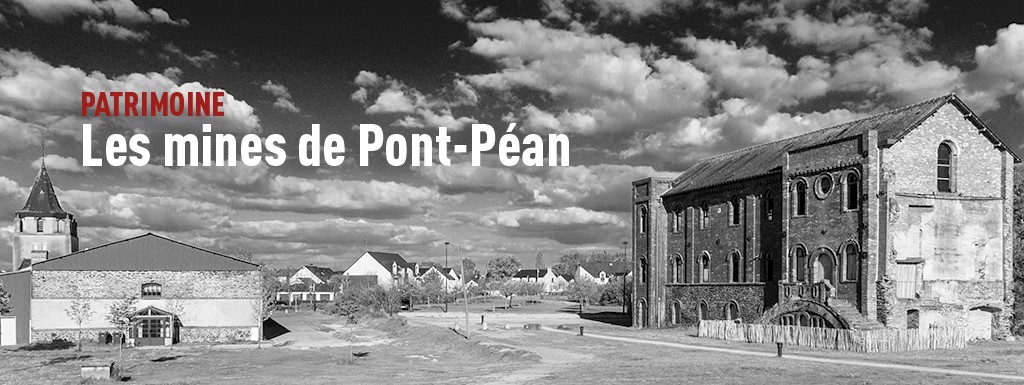Olivier Le Dour (suite)
Peu importe qu’il ait grandi au milieu des lettres et des livres, la vulgate de l’époque veut qu’un bac C mène à tout ce qu’on voudra. Après le collège à Bruz et le lycée à La Poterie, Olivier fera donc des sciences. Trois ans d’aventures sur le campus de Beaulieu et, licence de physique en poche, il quitte Rennes pour Strasbourg, Washington, Paris, puis Erlangen, la ville allemande jumelée à sa ville natale. Bardé d’un doctorat, ingénieur physicien spécialisé dans les technologies médicales, il finit par se fixer à Bruxelles où il est, depuis vingt ans, administrateur à la Commission Européenne, travaillant pour les services qui financent la coordination de la recherche médicale européenne ainsi que les collaborations entre équipes de l’UE, et encouragent le transfert des réalisations vers la pratique clinique.
À y regarder de plus près, ce CV très académique comporte quelques zones étranges, comme ces semaines de décembre 1993 à faire la manche dans le vent d’hiver des larges rues piétonnes de Nuremberg, grattant la guitare héritée de son père décédé trois ans plus tôt, un père qui chantait, écrivait des chansons et pour qui la musique comptait beaucoup. Chanter et faire le Jacques de temps en temps, deux travers qu’Heidi n’est pas parvenue à tempérer. Car Olivier n’est pas revenu seul d’Erlangen. Il l’a épousée à l’été 1999 à Langonnet, le village des grands-parents Le Dour, en présence d’une foule inhabituellement cosmopolite pour la localité. Les chamailleries qui agitent Nora, Layla et Morgane, dont les arrivées s’échelonnent entre 2001 et 2008, ajoutent à l’animation de leur foyer bruxellois.
C’est pour repousser le moment de rédiger son mémoire de thèse qu’Olivier commence, en juin 1993, à écrire sur autre chose que l’imagerie médicale : la première ébauche d’un projet sur l’émigration bretonne aux USA et au Canada. En effet, la branche paternelle de sa famille a, en 1880, contribué à lancer le courant d’émigration des Montagnes Noires vers l’Amérique du Nord, où est né son grand-père Yann Dour. La revue Ar Men publiera ce premier récit, ce qui l’encourage à entreprendre la rédaction d’une Histoire Générale des Bretons en Amérique du Nord, à partir des travaux de Grégoire Le Clech, restés très largement inédits, et de ses propres recherches. La rencontre avec Bernard Le Nail va lui permettre de concrétiser ce projet, en débutant par les épisodes les moins connus de ce phénomène. Après Les Bretons dans la ruée vers l’or de Californie, publié en 2006 par la maison d’édition rennaise de celui-ci, Les Portes du Large, suivront deux volumes consacrés aux réfugiés huguenots de Bretagne en Amérique, le dernier paru en 2013.
Si les retours à Rennes sont fréquents, celui qui fait l’objet du texte qu’Olivier nous a proposé est double : une visite très formelle dans du lycée qui n’est plus vraiment, trois décennies plus tard, celui de son adolescence, et un regard sur le destin des camarades perdus de vue, que quelques clics permettent désormais de découvrir
L’opération s’appelle Back to School. Retour à l’école. La France s’y prête pour la première fois en 2015. D’autres pays de l’Union Européenne le font depuis longtemps. Il s’agit de patronner et de faciliter le retour, pour une journée, de fonctionnaires des institutions de l’UE, Commission, Parlement ou Conseil, dans leur établissement d’origine. Raconter aux collégiens ou aux lycéens son expérience, ce que signifie servir l’Union, être fonctionnaire européen, ce qu’on fait de ses journées, pour l’Europe, ce que l’Europe fait pour la Bretagne, pour Rennes ; comment on part de ce lycée pour atterrir un jour à Bruxelles. Montrer qu’on n’est pas un fonctionnaire anonyme complètement déconnecté de la vraie vie, comme certains se complaisent à l’imaginer, mais qu’on a un vécu et une vie quotidienne, une vie professionnelle et une vie de quartier. Et qu’on a commencé comme vous, sur ces bancs.
Pour moi ce sera La Poterie. Pardon, le lycée René Descartes. Mais je ne m’y ferai pas. C’était le lycée La Poterie, point. L’accueil par les cadres, le proviseur et le professeur qui m’accompagnera, est impeccable. Leur conversation aussi. L’empathie pour les élèves, la hauteur de vue. Juste la bonne distance pour combiner la vision micro (le cas par cas) et macro (le cas général), comme on dirait à Bruxelles quand on s’y exprime – ça se fait rare – en français.
L’heure d’arrivée est mal choisie : tout le monde s’affaire autour d’une lycéenne allongée au sol, en hyperventilation. La date est également mal choisie. Ce 5 juin est le tout dernier jour des cours, avant les révisions du bac, mais on est parvenu à remplir pour moi l’amphithéâtre d’une centaine de gamins dont l’attention se maintiendra pendant deux bonnes heures. Une performance, m’assure-t-on.
Le rapport de mission dira des choses convenues, mais ne dira pas la charge émotionnelle de pareille piqûre de rappel pour le chargé de mission. Remettre les pieds à La Poterie pour la première fois 32 ans après le bac. Ce lycée, c’était mon choix. Accessible depuis Noyal-sur-Seiche par les cars bleus de la Sitcar. Accessible à vélo aux beaux jours. Un début de liberté : maman n’est pas dans l’établissement, ça me changera du collège. Et puis il y a un club d’échecs, avec une belle équipe : Desouches, Grandjean, Crosnier, Le Meur. L’année précédente, ils avaient battu notre équipe du collège de Bruz. J’avais découvert les lieux et choisi en connaissance de cause.
L’établissement n’avait pas beaucoup plus de trois ans d’âge. Un réseau de blockhaus au milieu des champs. Pas de métro, pas de troquet à proximité. Pas encore d’enceinte grillagée. Pas de tentations, mais un air de liberté, d’autogestion. Chaque classe avait sa propre salle, qu’elle pouvait décorer, un modèle peu fréquent pour l’époque. Une équipe dirigeante hilare un certain lendemain de mai 1981. Pas de foyer à proprement parler, mais un grand CDI, une salle de musique où on pouvait amener ses disques, une table de ping-pong, une salle pour jouer aux échecs, et le projet, pour M. Cadoret, le proviseur, et son équipe pédagogique recrutée dans les quartiers et communes de la périphérie, de montrer qu’on pouvait tailler des croupières à Zola et Château. Aujourd’hui, la ville s’est étendue autour du lycée. Il y a une nouvelle aile avec des labos modernes, et le grillage d’enceinte.
La Poterie 1983, rappel. Le grand Marcel, un géant black, qui faisait le guet pendant que je me glissais dans le bureau de Mme Morvan, la surveillante générale, piquer la fiche de Véronique, dont je voulais garder une photo que je n’aurais jamais osé lui demander.
Autrefois, pour savoir ce qu’étaient devenus les camarades de lycée après 30 ans, il aurait fallu un détective. Maintenant, même sans passer par Copains d’avant et Cie, il y a le dieu Google qui répond à la question : « Qu’as-tu fait de ton talent ? » Véronique faisait du tennis, je m’en souviens. Elle a encore gagné des tournois il y a quelques années, quelque part plus à l’ouest. Annie – mon béguin platonique de 1re – faisait du théâtre. Elle en fait toujours, avec une troupe itinérante. Et puis s’affiche ce titre : « François C. (Iffiniac) remporte le premier open de Montfort ». Open d’échecs, pas de tennis. François, au lycée, je me confrontais quotidiennement à lui à la pause de midi, devant l’échiquier.
Il était petit, un an plus jeune et donc une classe derrière la mienne, sûr de lui, un peu hâbleur. Nous étions en gros du même niveau et avons commencé ensemble à faire un peu de compétition, au-delà du championnat scolaire d’Ille-et-Vilaine par équipes, en nous inscrivant au Cercle Paul-Bert, le prestigieux club régional du champion de France junior, Thierry Brionne, et des champions de Bretagne Éric Boulard ou Pierre Théon.
François, encore un, donc, qui a persévéré. Mais le plus prometteur de tous c’était Gouret. L’année de ma terminale, celle de mes 16 ans, est arrivé au lycée un vrai champion, mais un champion à part, Thierry Gouret. Thierry avait mon âge. Il était grand et mince, une bonne tignasse de cheveux raides, plantés drus sur le crâne, et beaucoup d’assurance. Brillant joueur, il était déjà champion de Bretagne chez les cadets, ou les juniors, je ne suis plus trop sûr. Surtout, il s’écartait totalement du modèle standard du joueur d’échecs. C’était un littéraire dans un monde de mathématiciens, un délinquant caustique, au ton moqueur et corrosif dans un univers de gens sages. Un joueur doué qui ne travaillait pas, où s’efforçait de ne pas le laisser voir, ni aux échecs, ni au lycée. Il venait d’une famille modeste. Ses parents habitaient une petite maison dans la rue Jean Le Ny. Cela m’étonnait un peu qu’à des gens aussi simples soit né un fils au caractère et à l’intelligence aussi frappants. Charismatique, Thierry cultivait cette apparence de dilettante et de « petit dur » : il fréquentait des lycéens parmi les plus dissipés, répétait avec eux dans un groupe punk. Je l’admirais par son génie et parce qu’il s’écartait vraiment de la norme. Il devait être un vrai cauchemar pour ses profs, sauf celui de lettres, sans doute. Dans les quelques tournois auxquels j’ai participé avec lui, il arpentait les travées avec cet air dégagé, incroyablement sûr de lui, arborant parfois un grand sourire moqueur. Souvent une cigarette au bec mais encore plus souvent une canette de bière à la main. Quand venait le moment de conclure sa partie, il s’asseyait enfin, totalement concentré, imperturbable, statufié, à l’exception du geste qui déplace la pièce et arrête la pendule qui décompte son temps de réflexion pour relancer celle de l’adversaire.
Nous étions devenus assez copains. Pas des grands amis : de bons amis. Il se livrait peu, gardait un air narquois. Il m’aimait bien et ça me flattait qu’un type comme lui accepte parmi ses copains un élève d’apparence aussi peu rebelle que moi, un Terminale C, avec mon gros cartable, mes grosses lunettes et mon gros manteau. Dans sa chambre, une cinquantaine de disques, fauchés chez Dialogues ou Rennes-Musique pour la plupart, représentaient tout ce qui pouvait symboliser le trouble à l’ordre public : les Doors, le Gun Club, MC5... Il se moquait gentiment de mes goûts trop conventionnels : Pink Floyd, Springsteen, Led Zeppelin ou Genesis.
Thierry le mauvais garçon avait un ascendant sur moi, une mauvaise influence dont je garde un bon souvenir. Sur mes 400 coups de collégien, lycéen et étudiant, il est sûrement lié à la moitié d’entre eux, concentrés sur cette année de terminale 1982-83. II y a prescription mais je ne peux pas raconter, ça ferait de la peine à ma maman.
Puis, j’ai eu mon bac, je suis parti à la fac des sciences. Je ne l’ai plus jamais revu. J’ai entendu qu’il avait abandonné le lycée avant la fin. Par un ami du service national qui jouait aussi aux échecs, j’ai eu quelques nouvelles de lui. Il était devenu semi-professionnel, avec un classement international, un requin des tournois français, un chasseur de primes. Si je me souviens bien, il était proche d’une des grandes joueuses française, bien plus âgée que lui. Il devait donc plus ou moins gagner sa vie en jouant aux échecs. Peut-être difficilement. S’étaitil assagi ? À force d’écumer les tournois, a-t-il enfin, un jour, décroché une norme de Maître International, une belle victoire sur un grand joueur ?
« Thierry Gouret, qu’as-tu fait de ton talent ? » Google est efficace, mais ne fait pas de sentiment. Le quatrième site répertorié écrivait : « La Ligue d’Île de France rend hommage à Thierry Gouret, décédé le 14 juillet au matin. Il avait réussi un excellent Championnat de Paris en obtenant la 6e place ex aequo de l’Open A. Sa dernière partie du Championnat sera publiée dans le bulletin du championnat, prochainement disponible. Nous nous associons à la peine de tous, (etc.) ».
La page date de 2003. Le site de la Fédération Française est laconique : « Tragique décès de Thierry Gouret. Joueur bien connu du club de Gonfreville, habitué de la Nationale 1 et des Opens, Thierry Gouret a été découvert inerte au pied d’un pont, près de la Seine, la nuit du 14 juillet ». Sur un autre site, une photo le montre l’année précédente, jouant en Hongrie, très arrondi par rapport au jeune homme que j’ai connu, le visage mangé par une barbe, et toujours une bière à la main comme par le passé.
Pierre Théon, qui fut aussi prof de maths à Rennes, écrivait peu après sa disparition1 : « Thierry, [à] 12 ans, s’était vite imposé dans notre équipe [du cercle Paul-Bert] autant par son talent de joueur que par sa vivacité et son humour déjà particulier, lié à un regard amusé sur nos comportements sociaux. [...] Je recherchais particulièrement [sa] compagnie pour participer à des opens, toujours dans l’espoir qu’une forme d’inspiration le gagne, souvent sur l’échiquier, mais aussi dans les moments de détente où il se laissait aller à ses divagations brillantes, poétiques et drôles. Sans concession, il a choisi d’arrêter ses études en 1re littéraire malgré d’évidentes facilités et de même, bien plus tard, alors que je l’exhortais à davantage de discipline pour décrocher un titre de maître international, il me répondait que les “diplômes”, quels qu’ils soient, lui semblaient quelque peu suspects. Je lui ai proposé de me rejoindre au club de Gonfreville dans les années 90, non sans quelques inquiétudes car je le savais provocateur et de plus en plus imprévisible. Mais Thierry a su apprécier une équipe plutôt décontractée qui l’a très vite intégré, et joué un rôle décisif dans [sa] montée en division 1 [...] Voilà, Thierry vivait avec une telle souffrance qu’il s’est épuisé malgré tous ses talents. Il était néanmoins un ami attentif et sensible, et je l’ai parfois vu terriblement désolé pour ses proches lorsque ses errances les avaient blessés ».
Un autre de ses amis, Laurent Chapu, qui l’a connu dans les années 1990 et 2000, écrivait : « Outre le jeu d’échecs dont il ne peut se passer, Thierry a une passion au sens propre du terme : l’écriture. Thierry écrit, beaucoup, tous les jours, sur tous les supports, tickets de métro ou cahiers d’écoliers. Il écrit sur l’actualité, sur ses parties, de la poésie, des réflexions profondes ou des romans légers. C’est un véritable volcan de l’écriture qui se cache derrière ce joueur d’échecs, avec un style bien particulier, peut-être le style des très grands. Aujourd’hui ce sont des centaines de cahiers, des milliers de textes qu’il laisse derrière lui. »
Mon ami Thierry Gouret est mort sans que je n’en sache rien alors. Plusieurs sites parlent de suicide. Il avait manifestement conservé ce côté dysfonctionnel, cette révolte muée en mal de vivre.
Hier, j’ai refait quelques-unes de ses parties. Internet permet cela aussi. J’ai choisi des parties qu’il a gagnées, et je me suis glissé dans sa tête, pour faire revivre pendant quelques minutes cette intelligence fantasque que j’ai beaucoup admirée aux jours du lycée et qui s’est éteinte au pied d’un pont de la Seine il y a douze ans.