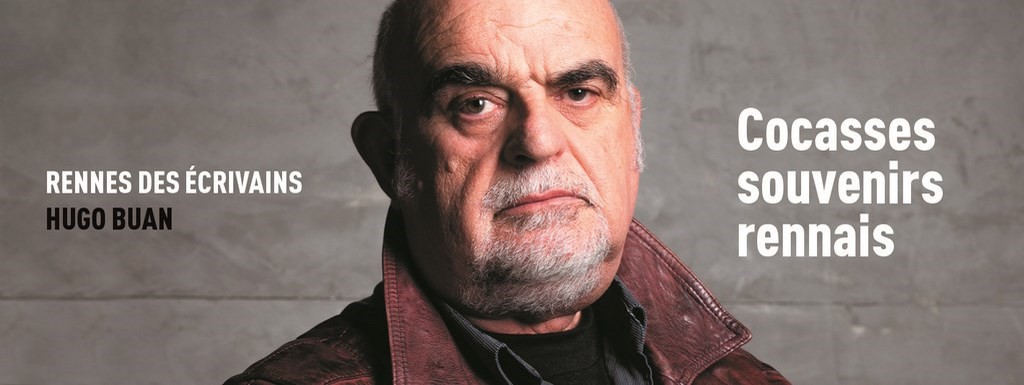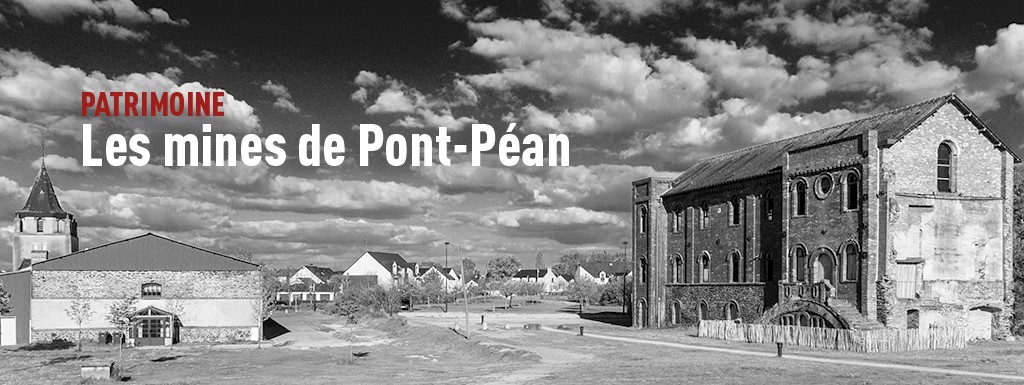En dépit des fortes disparités caractérisant les politiques territoriales en Europe, les frontières politico- administratives héritées de l’Histoire ne pouvaient constituer l’unique base de rayonnement de l’action publique locale. Ce constat se vérifie avec une acuité toute particulière en France où la Révolution accoucha fin 1789 de 44 000 communes, sur la base d’un découpage paroissial amendé. Ce design territorial devait se voir aménager à mesure que les nécessités originelles du projet de centralisation administrative (favorisé par l’existence de ces communes si petites et si peu autonomes) devenaient moins impératives, et que les défauts d’une telle armature territoriale apparaissaient toujours plus remarquables. Alors que les tentatives de fusion de communes ont toujours échoué, c’est à travers la voie coopérative qu’ont pu s’ajuster les échelles fonctionnelles (là où se posent et doivent se gérer les problèmes) et les échelles institutionnelles (là où s’établissent des institutions élues). Cette coopération aboutit progressivement, par étapes, à une triple intégration : intégration des compétences d’abord avec le transfert de compétences communales vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; intégration fiscale ensuite, avec des transferts de la fiscalité ménage et/ou de la fiscalité économique ; intégration des ressources humaines enfin, avec la politique de mutualisation des services (mises à disposition « descendantes » ou « ascendantes » de services selon que le service communautaire agit pour le compte de communes, ou qu’un service communal agit pour le compte de l’EPCI ; gestion unifiée du personnel, avec la constitution d’une seule entité administrative).
Si la « révolution silencieuse » de l’intercommunalité embrasse l’ensemble des territoires, c’est en milieu urbain que son intégration apparaît la plus poussée. La constitution de gouvernements urbains accompagne ainsi les logiques de métropolisation assises sur des flux économiques et sociaux qui échappent aux limites territoriales existantes. Cette dynamique proprement urbaine, de nouveau inscrite à l’agenda politique, se voit placée au coeur de la réforme territoriale initiée par François Hollande au lendemain de son élection. Bien qu’elle traduise une promesse de campagne, ce type de réforme s’apparente moins à une «politique électorale» ou d’« opinion » opérant à travers des épreuves publiques particulièrement ouvertes, et correspond davantage à une « politique des problèmes » adressée à des publics spécifiques. Renonçant à promouvoir un seul grand texte décentralisateur, le gouvernement a fini par privilégier un taylorisme législatif consistant dans l’examen et le vote séparés de trois projets de loi présentés en Conseil des ministres le 10 avril 2013. Derrière le projet de consolidation des dynamiques urbaines inhérent au premier des trois textes, celui relatif « à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles », s’attache la croyance autour du lien de causalité entre le rôle de locomotive qu’endosseraient des principaux ensembles urbains et la compétitivité des territoires. Face à la tradition française d’uniformité émerge une différenciation toujours plus poussée des gouvernements urbains et non-urbains, au risque de générer un territoire à deux vitesses.
La consolidation des dynamiques urbaines proposée par le projet opère à travers une triple réorganisation institutionnelle, l’agglomération rennaise étant plus spécifiquement concernée par celle du milieu. Au-dessus, la voie de réforme vise à octroyer des statuts particuliers aux trois principales agglomérations françaises : créer le «Grand Paris» en faisant coopérer la ville de Paris et l’ensemble des communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de- Marne) dans un seul établissement public ; transférer les compétences du conseil général du Rhône vers la métropole lyonnaise dans les limites de son territoire ; créer la grande métropole d’Aix-Marseille-Provence en fusionnant la communauté urbaine de Marseille avec cinq autres communautés et syndicats d’agglomérations (la métropole serait alors divisée en territoires dotés, chacun, d’un conseil, aux compétences essentiellement consultatives). En-dessous des métropoles à statut spécial, la réforme vise à aligner par le haut le statut des communautés d’agglomération sur celui des communautés urbaines.
Bien qu’elle soit une communauté d’agglomération, l’avenir de Rennes Métropole se joue à l’étage intermédiaire des métropoles. La réforme cherche en effet à relancer les métropoles créées par la loi du 16 décembre 2010, et dont le succès tardait à se manifester. Après avoir évoqué des « communautés métropolitaines », de manière à opérer un démarquage sémantique par rapport à l’ancienne majorité, le gouvernement s’est finalement ravisé en maintenant ce terme de « métropoles ». Leur relance repose d’abord sur l’abaissement du seuil d’éligibilité de 500 000 à 400 000 habitants. Ce seuil purement conventionnel avait fait l’objet, au cours la précédente réforme, d’ajustements. C’est en effet le Sénat qui, par l’entremise du sénateur UMP d’Ille-et-Vilaine Dominique de Legge et par voie d’amendement, avait porté le seuil de 450 000 habitants, retenu par les députés, à 500 000 habitants. Cette initiative mettait alors fin aux espoirs de Daniel Delaveau et de sa majorité (tant municipale que métropolitaine) d’accéder à court terme à ce nouveau statut métropolitain. En abaissant désormais le seuil de création à 400 000 habitants, le législateur ouvre des perspectives juridiques nouvelles pour que « Rennes métropole » (population totale de 414 475 habitants au 1er janvier 2013) cesse de relever du seul marketing territorial et coïncide avec un authentique statut.
Mais que recouvre plus concrètement ce changement de statut ? Le précédent projet, en 2010, avait enregistré une révision à la baisse des ambitions entre les propositions du Comité Balladur et le texte de loi finalement voté, passant d’un transfert de droit d’un certain nombre de compétences vers un transfert essentiellement conventionnel. Autrement dit, rien ne peut se faire sans l’accord des parties concernées, certaines n’étant pas disposées à se « déshabiller » au profit des métropoles. Un exercice de plein droit par la métropole était prévu pour trois compétences seulement : en lieu et place du département (pour les transports scolaires et la voirie) ou de la région (pour les compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques).
En accédant à l’avenir à ce statut de métropole, l’agglomération rennaise pourra d’abord se prévaloir des acquis de 2010, et surtout bénéficier de nouveaux transferts de compétences de la part des communes et l’état, et également de transferts facultatifs de compétences départementales et de compétences régionales, par voie de convention :
- concernant les transferts de compétences des communes vers les métropoles, de nouvelles prérogatives sont intégrées au bloc de compétences « Protection et mise en valeur de l’environnement »: concession de la distribution publique d’électricité, création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, gestion des milieux aquatiques.
- concernant les transferts de compétences départementales, intervenant de plein droit au 1er janvier 2017, la réforme prévoit, outre les transports scolaires et la voirie déjà inscrits dans la réforme 2010, une longue liste de nouvelles prérogatives : attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement; missions confiées au service départemental d’action sociale ; adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d’insertion ; aide aux jeunes en difficultés ; actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ; zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques….
- enfin, la métropole voit ses compétences en matière de logement renforcées avec une délégation, sur demande, d’un ensemble indissociable de cinq compétences de l’État: attribution des aides à la pierre, garantie du droit au logement décent, gestion du contingent préfectoral, droit de réquisitionner des locaux vacants, gestion des dispositifs concourant à l’hébergement des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés à se loger en raison de leurs ressources.
Cette consolidation des dynamiques urbaines, liant la question des compétences, des moyens financiers et des moyens humains, laisse néanmoins sur le bord de la route deux questions essentielles qui sont autant de verrous du pouvoir communal : la qualification juridique de l’intercommunalité et l’absence d’élections directes et séparées des conseillers communautaires. Les points de veto au changement ne sont pas séparables des élus locaux. Outre leur nombre particulièrement élevé en France, qu’induit le très grand nombre de communes, cette coalition de cause et d’intérêt opère d’abord par le truchement d’associations d’élus, constitués en puissants groupes d’intérêt agissant au travers de représentations nationales diverses et spécialisées. Leur capacité d’influence est d’autant mieux assurée que ces lobbies territoriaux sont dans les murs en raison de la pratique « exceptionnellement » élevée du cumul vertical des mandats. S’il apparaît plus difficile d’identifier du côté de la population des stratégies ordonnées, lorsque les Français sont interrogés par sondage sur l’hypothèse de suppression d’un échelon territorial, l’intercommunalité arrive au premier rang des réponses.
Le premier verrou recouvre le statut proprement dit pour lequel le législateur semble avoir retenu les leçons de la précédente réforme territoriale. Alors que les travaux du Comité Balladur avaient envisagé de faire des métropoles d’authentiques collectivités territoriales, les débats parlementaires avaient eu raison d’une telle audace, se rangeant à l’avis exprimé en 2009 par le bureau de l’Association des Maires de France : « les structures intercommunales doivent conserver des compétences d’attribution, transférées par les communes ou conférées par la loi. Elles ne peuvent en aucun cas devenir des collectivités de plein exercice, faute de quoi la commune disparaîtra ». Aussi, le confinement du pouvoir intercommunal trouve une traduction forte sur le plan juridicopolitique en faisant des institutions intercommunales des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) privés de la clause générale de compétences et obéissant à l’idée d’une vocation spécialisée : ils ne font que ce qu’il leur a été expressément attribué. Sur un plan plus empirique, l’évocation d’établissements publics pour désigner des communautés très intégrées relève d’une fiction juridique au regard de la densité et de la diversité des compétences communautaires, a fortiori dans les espaces urbains. Mais dans un contexte où prédomine l’idée de surpeuplement du paysage politicoadministratif local français, créer un nouveau rang de collectivités territoriales sans en supprimer un déjà existant apparaît difficilement concevable. Autrement dit, la transformation des EPCI en authentiques collectivités territoriales recèle le risque, pour les communes, d’un déclassement. Dans une sorte d’inversion juridique, les communes seraient conduites à devenir de « simples » composantes des intercommunalités. Aussi le gouvernement s’est-il bien gardé d’accompagner la consolidation des dynamiques urbaines d’une promotion statutaire.
De manière tautologique, l’absence d’élection directe des conseillers communautaires au suffrage universel (désormais amendée à la marge) est à la fois la raison et la conséquence de cette qualification juridique. Cette question de la légitimité démocratique n’a cessé d’être posée depuis le redéploiement spectaculaire des intercommunalités dans les années 1990. La raison en est simple : les élus siégeant au sein des EPCI ne sont « que » des élus du suffrage universel indirect. De cette absence d’élections communautaires naît le sentiment d’un trop grand décalage entre l’espace d’agrégation des votes, c’est-à-dire le cercle où les suffrages sont sollicités pour départager les options proposées au scrutin et l’espace institutionnel, c’està- dire le cercle où les décisions sont prises et appliquées. Si la « confiscation » du pouvoir intercommunal déborde l’élection stricto sensu, celle-ci figure traditionnellement au premier rang des solutions visant à pallier le trop faible contrôle citoyen du pouvoir intercommunal.
Force est de constater que la réforme ne fait franchir aucun pas significatif à court terme dès lors qu’elle reporte l’hypothèse d’une élection directe et séparée aux élections municipales de 2020 : les députés ont adopté en première lecture un amendement gouvernemental établissant l’élection directe d’une moitié des conseillers communautaires dans les seules métropoles (dont l’agglomération rennaise). Ce report n’a pas empêché l’Association des Maires de France dénoncer le risque de création d’une « nouvelle collectivité territoriale supplémentaire, sans rationalisation d’aucun autre niveau ».
Pour les seules élections municipales de 2014, la réforme se contente d’amender et de préciser les acquis de la précédente réforme territoriale du 16 décembre 2010. Alors que le seuil démographique d’application des scrutins de liste aux élections municipales est établi à 1000 habitants (contre une prévision de 500 habitants précédemment), le législateur maintient le principe d’un système de fléchage, en y introduisant certaines évolutions. En mars 2014, les électeurs des communes de plus de 1 000 habitants trouveront sur leurs bulletins de vote deux listes distinctes de candidats : l’une pour le conseil municipal et l’autre, dérivée de la première, pour le conseil communautaire. Le fléchage est ici en trompe-l’oeil dès lors qu’il concède aux « faiseurs de listes » une capacité décisionnelle encadrée, au détriment des citoyens empêchés de choisir par eux-mêmes et séparément (deux bulletins de vote) les futurs conseillers communautaires.
Pour établir la liste des candidats aux fonctions de conseiller communautaire dans les communes de plus de 1 000 habitants, les faiseurs de listes devront respecter un certain nombre de règles concernant le nombre, l’ordre de présentation sur la liste intercommunale (identique à l’ordre des listes municipales, en sachant que le premier quart des candidats communautaires doit être situé en tête de liste des candidats au conseil municipal et que tous les candidats communautaires doivent figurer dans les trois premierscinquièmes de la liste des conseils municipaux ), et enfin la parité (alternance de candidats de chaque sexe). Sur ce dernier point, les conseils communautaires connaissaient, comme les conseils généraux, un retard conséquent en termes de féminisation des assemblées. Le rattrapage communautaire s’effectuera à côté du rattrapage départemental, l’introduction d’un scrutin binominal imposant une strict parité : dans le cadre de cantons élargis, l’électeur se verra proposer d’élire des tickets (et non plus des candidats) invariablement composés d’un homme et d’une femme. En tout état de cause, la commune continue de détenir un monopole électif qui représente bien souvent, pour des petites communes, leur plus puissant registre de légitimation. Ce système fléché préserve un ordre institutionnel intergouvernemental adossé aux logiques de compromis territoriaux. Il continue de privilégier une représentation des communes, plutôt qu’une représentation des populations assise sur des bases démographiques. Il maintient l’institution intercommunale dans des formes classiques de politisation, celles assises sur des logiques adversoriales fondées sur les affinités partisanes et jouant de la dramatisation des conflits.