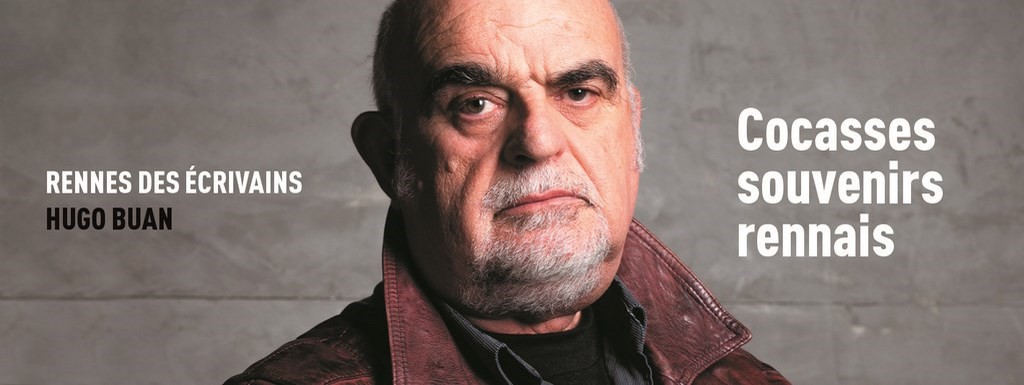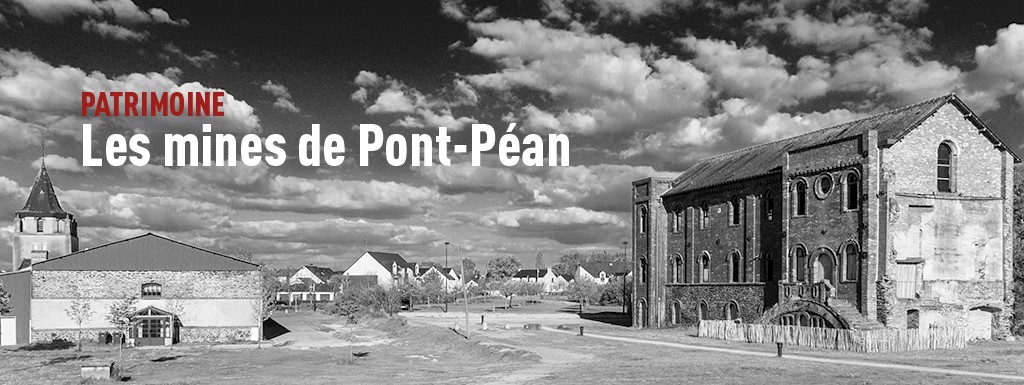Plouc dans un collège rennais
C’est en travaillant au lancement de ce titre que le rédacteur en chef Bothorel prit conscience de son identité bretonne et du sort que l’État réservait aux régions, dont la Bretagne. Il adhéra alors au FLB (Front de libération de la Bretagne) et créa en 1968 une cellule de ce mouvement à Paris. C’est alors qu’il participa à plusieurs attentats dans la région parisienne contre des pylônes électriques et une canalisation d’eau. Arrêté, emprisonné à la Santé, il en sortit au bout de six mois, bénéficiant d’une amnistie prononcée par le président Georges Pompidou à l’occasion du 14 juillet 1969. Avec humour et distance, Jean Bothorel a raconté dans un livre (Un terroriste breton, 2001) ce qui l’avait amené à suivre la cause autonomiste et son action violente pendant une brève période.
La carrière de journaliste de Jean Bothorel se confond avec l’histoire de la presse parisienne depuis plus de quarante ans : rédacteur à L’Expansion, reporter à La Vie catholique, éditorialiste au Matin de Paris, membre du comité éditorial du Figaro, rédacteur en chef à L’Express… Parallèlement, Jean Bothorel écrit des ouvrages d’analyses politiques et des livres polémiques classés à droite. Il a surtout développé avec talent l’art de la biographie en l’exerçant sur des écrivains tels que Louise de Vilmorin, Georges Bernanos, Bernard Grasset ou bien sur des grands patrons tels qu’Ernest-Antoine Seillière, Jean-Jacques Servan-Schreiber, François Pinault, Vincent Bolloré… S’y ajoutent des livres d’entretiens, avec Pierre Mendès- France, Raymond Barre et Théo Klein.
Le journaliste a aussi écrit des livres plus personnels, comme Toi, mon fils qu’il publia en 1986 sur l’addiction de son fils à l’héroïne. Ce témoignage sensible et lucide toucha un très large public.
Dans le texte que nous publions ici, Jean Bothorel évoque deux épisodes de sa vie qui lui firent croiser la ville de Rennes. Le premier au début des années cinquante quand, venant de sa campagne, il fréquenta les classes de sixième et de cinquième du collège Saint- Vincent. Le second en juin 1968 quand il fut candidat aux élections législatives d’après-Mai dans la circonscription de Rennes-nord sous l’étiquette autonomiste du « Front breton-Talbenn Breizh ». Deux épisodes certes moyennement glorieux mais qui font remonter la saveur, fût-elle amère, de toute une époque rennaise.
De Rennes, je ne garde pas un souvenir « plein de lumière » comme dit le poète. Nous sommes en septembre 1951, un parfum d’après-guerre flotte encore. J’ai onze ans et je rentre en classe de sixième dans un célèbre internat religieux dont le nom m’écorche encore la voix. Mes parents m’accompagnent, et nous avons fait la route depuis Plouvien, un bourg du pays du Léon, dans une grosse Citroën. J’ai vomi tous les cinquante kilomètres. En me quittant, ma mère s’effondre en larmes. J’ai le cafard. Il pleut toujours en ces heures de rentrée. Finis la découverte et l’inventaire du monde au fil des talus, des ruisseaux, des étangs dans les vallées de l’Aber-Benoît et de l’Aber-Wrac’h. J’en avais pour trois mois. Pas de weekend, pas de vacances avant Noël. C’était ainsi.
Le jeudi suivant la rentrée, le béret sur la tête, la pèlerine bleu marine sur les épaules, je marchais avec la troupe des potaches en rangs serrés par trois dans les rues de Rennes. Cela s’appelait la « promenade des internes ». Une Citroën identique à celle de mes parents déboucha d’un carrefour. Je m’exclamais : « Mon père a la même, avec la malle arrière ! », et tous mes petits camarades de s’esclaffer : « La mâââlle, la mâââlle… ». Mon accent du Léon m’était renvoyé en pleine gueule. Je n’arrive pas à me souvenir de l’intonation avec laquelle je prononçais ce mot, mais on me surnomma « la mâââlle », ce qui, chaque fois, me renvoyait à mes origines, si j’ose dire, ethniques. Ce fut ma première impression d’appartenir non pas à une nation, mais plus simplement à un milieu spécifique.
J’ignorais alors que Rennes était une cité « gallo », pas une cité bretonnante. Gallo veut dire « qui parle galleg » (français). À l’origine la Haute-Bretagne comprenait les trois évêchés « gallo » de Rennes, Nantes et Vannes ; la Basse-Bretagne, la mienne, les évêchés bretonnants de Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon et Quimper. Aujourd’hui, la Basse-Bretagne est la partie située à l’ouest d’une ligne Plouha-Le Pouldu. Mon accent était celui d’un « plouc », et chaque fois que j’entendais « la mâââlle ceci, la mâââlle cela », j’avais bel et bien la cruelle impression d’être ce « plouc » sans, toutefois, établir une quelconque équation d’égalité entre « plouc » et Breton. En effet, si je suis né en Bretagne, je ne suis pas né breton. Par quelle étrange alchimie le suis-je, soudain, devenu ? Pourquoi ai-je en 1968, adhéré au FLB (Front de Libération de la Bretagne) et pris le risque d’hypothéquer toute une vie en participant à plusieurs attentats avant d’être enfermé à la prison de la Santé ?
Ces questions me sont souvent posées et je me les pose aussi moi-même tant il est vrai que le sentiment d’un lien m’unissant à la terre d’Armorique ne m’a pas été donné. À tel point qu’en 1951, dans mon internat rennais, j’avais honte de mon accent. Il me rappelait les paysans, les commerçants de mon bourg natal, il me rappelait la distance qui me séparait de la ville, et j’avais encore un peu plus le cafard.
On s’entassait à quarante, cinquante élèves dans des dortoirs humides et froids qui puaient la sueur, les pieds et les flatuosités. Le soir, après l’extinction des feux, s’organisait un tel lâcher de pets que les pions ne cherchaient plus à en interrompre le rythme. Le matin, à 5 h 35, transi, maussade, on gagnait machinalement le lavabo, une interminable vasque en tôle au-dessus de laquelle s’étirait un tuyau percé d’une vingtaine de trous. On s’alignait, torse nu, le pion ouvrait le robinet et une eau glaciale jaillissait de chaque orifice, éclaboussant nos peaux blafardes. Après une toilette vide expédiée, nous descendions en salle d’étude, puis à la chapelle avant d’envahir le réfectoire. À 8 heures démarraient les cours. Et la journée s’écoulait, réglée comme par un métronome. Messe, cours, étude, réfectoire, cours, étude, réfectoire, étude, dortoir…
Pourquoi Rennes, à 250 kilomètres de Plouvien, alors que le Finistère regorgeait d’excellents internats ? Parce que ma soeur aînée y préparait l’agrégation d’histoiregéographie et pouvait ainsi me sortir le dimanche, de 11 h 30, après la messe, jusqu’à 18 heures avant la célébration du Saint-Sacrement. Nous déjeunions au Café de la paix ou dans un charmant restaurant du vieux Rennes médiéval, Le du Guesclin. On y mangeait un excellent ris de veau qui rivalisait avec celui que me préparait ma mère. Depuis, de tous les abats, le ris de veau est le seul dont s’accommode mon assiette. L’après-midi nous allions souvent au cinéma dans une salle d’art et d’essai, près de la cathédrale, baptisée Ciné Club où à l’issue de chaque film, on débattait sur le pourquoi, le comment, la morale, l’objectif du metteur en scène, etc. Ma passion du cinéma est née à ce moment-là. Le collège, à sa façon, enseignait l’austérité, la méfiance, le péché. Nous pataugions dans ce puritanisme étroit, cette religion de la crainte et non de la confiance. Nous assumions la province : sa peur de l’autre, du sexe, de la liberté, sa peur de la civilisation moderne et technologique qui naissait. L’Amérique commençait d’imposer ses goûts et ses modes. Tout ce qui relevait du plaisir nous était ou interdit ou autorisé avec parcimonie. Avec le recul, je ne condamne pas ce jansénisme. Une échelle ne tient pas seule debout, il faut un mur pour la soutenir. Le collège était ce mur sur lequel nous nous sommes appuyés pour grandir. Le film de Pascal Thomas, Les Zozos, dont l’action se déroule dans un internat catholique de Bourges, rend merveilleusement compte de l’ambiance qui régnait alors dans ce type d’établissement.
Au fond, durant ces années étouffantes et à demi étouffées – ma sixième et ma cinquième – je n’ai de Rennes, de la ville de Rennes, aucune image frappante, sinon le jardin du Thabor, la route de Fougères, la cathédrale et ce singulier carrefour du Mail qui ressemblait à un no man’s land. Il y avait des bistrots où sur la vitrine un panneau indiquait, « ici on peut apporter son boire et son manger ».
En juin 1953 j’ai quitté Rennes ; ma soeur avait réussi l’agrégation. À la rentrée, j’ai intégré la quatrième à Quimper, dans un des plus grands pensionnats de France. Il l’est encore. Des curés, je passais chez les frères des Écoles chrétiennes. Ce fut plus libéral.
En 1968, après les événements de Mai, j’ai retrouvé Rennes. Lorsque le général de Gaulle prononça le 30 mai la dissolution de l’Assemblée nationale, j’ai décidé de me présenter aux élections législatives qui eurent lieu dans la foulée. Depuis deux ou trois ans je m’investissais de plus en plus dans les mouvements autonomistes bretons et, pour la circonstance, nous avions créé un parti, le Front breton – Talbenn Breizh – avec l’espoir de susciter quelques vocations. Seulement deux candidats affronteront le suffrage universel, Pol Le Doré à Lannion, moi-même dans la circonscription de Rennes-nord, celle d’Henri Fréville, maire centriste, et du gaulliste Jacques Cressard. Ce fut une candidature improvisée, sans un sou, avec le soutien d’une trentaine de jeunes militants.
Mon suppléant, Pierre Roy, était très connu à Rennes pour son engagement dans les associations culturelles bretonnes et pour ses activités sociales. Son altruisme autant que son intégrité morale m’assuraient, sinon des voix, du moins un courant de sympathie. De fait, près de deux mille personnes se pressèrent à notre réunion publique sous la halle centrale de Rennes. Le meeting de loin le plus couru de la campagne. Dans la salle, Alan Al Louarn lança : « Notre sol est riche, nous avons de l’eau, nous avons la mer, oui, les Bretons doivent prendre en main leurs propres affaires ! »
Qui n’a pas connu Alan Al Louarn ne comprendra jamais ce que la Bretagne peut susciter dans le coeur et l’esprit d’un homme. Toujours fraternel, toujours sur la brèche, c’était le savant cosinus de l’Emsav1, qui recevait à toute heure du jour et de la nuit dans son capharnaüm du 30 place des Lices, où il habitait avec sa tribu. Au premier étage, qui était aussi le siège du MOB (Mouvement pour l’organisation de la Bretagne), il avait réuni un extraordinaire musée de tout ce qui s’écrivait sur la Bretagne. Au rez-de-chaussée se tenait le BIP, Bureau d’information publicitaire, où il classait les dizaines et les dizaines de clubs, cercles, mouvements professionnels, politiques, culturels bretons. Il soutenait également un des nombreux cours de breton par correspondance, le Saded.
Mon score électoral fut loin d’être proportionnel au succès du meeting. Sinon, j’étais à coup sûr élu ! J’ai récolté 1 157 voix, soit 2 % des suffrages. Ce n’était pas ridicule dans un scrutin marqué, après les grandes peurs de Mai, par une impressionnante poussée du parti gaulliste. End of the story.